Philippe Robert-Tanguy est sociologue des organisations, fondateur du cabinet Alis Management et à ce titre, il a été missionné sur une enquête menée en deux volets. Au gré dans un premier temps de diagnostics prospectifs socio-économiques réalisés dans des TPE, puis dans des PME de plus de 50 salariés, il s’agissait de dégager les facteurs de changement et les tendances d’évolutions des métiers, emplois et qualifications, au sein des Industries Graphiques. Un travail au long cours dont il livre ici quelques enseignements…
On attend souvent des études telles que celle que vous avez menée, qu’elles nous donnent des enseignements englobants et généraux sur une industrie. Mais est-ce que ce n’est pas compliqué de définir des traits communs dans une branche d’activité très hétérogène en termes de taille d’entreprise, de technologies d’impression et bien sûr de produits imprimés, les logiques n’étant pas les mêmes selon que l’on soit positionné sur de la presse, de la notice pharmaceutique, du prospectus publicitaire ou du livre ?
Le secteur des industries graphiques est effectivement difficile à cerner, dans le sens où délimiter son périmètre est complexe en soi. Statistiquement, on a du mal à le faire : les entreprises qui impriment peuvent être rattachées à différentes nomenclatures – codes NAF et IPCC – et toutes ne sont pas identifiées comme des imprimeries. Par ailleurs, on se trouve face à des marchés et des produits finis très différents : la presse, la notice pharmaceutique, le packaging, l’imprimé commercial, les imprimés administratifs etc. Mais en dépit de dynamiques et de perspectives différentes, on observe que les métiers de la chaine graphique, depuis la composition jusqu’à la finition en passant par tous types d’impressions (offset, impression numérique, sérigraphie, flexographie etc.) sur tous types de supports, sont amenés à évoluer en profondeur en termes de relation client. On constate une forte montée des exigences chez les donneurs d’ordre, alors que les compétences techniques chez ces derniers ont diminué. Le raccourcissement des délais et une volonté d’aller plus loin dans les services additionnels amènent beaucoup d’entreprises à se développer sur de nouvelles activités, notamment en termes de gestion de stocks et de logistique. On voit donc, malgré les disparités évoquées, des tendances très similaires quant à la façon de traiter la demande.
« L’imprimeur doit monter en puissance sur les notions de conseil et de services. »
Est-ce que cette évolution s’est déjà traduite dans les entreprises ? Les imprimeries ont-elles concrètement et massivement endossé ce rôle de prescripteur ?
Oui, et si on prend le labeur traditionnel qui est beaucoup tiré par des marchés dits « historiques » – prospectus et communication, notamment – ce besoin d’apporter du service est encore plus prégnant. Les communicants sont aujourd’hui surtout formés aux modes de communication numériques et ils sont plus à l’aise pour parler de digital que de Print. C’est à l’imprimeur d’être force de proposition et de s’attacher à comprendre les problématiques de communication exprimées par leurs clients. C’est à l’imprimeur/fabricant d’en déduire les traductions « techniques » : quels procédés d’impression ? Quels formats ? Quels papiers ? Quelle finition ? Comment intégrer des exigences de production responsable ? Comment éco-concevoir et diminuer la consommation d’encres, par exemple ? Etc. Le fabricant doit mettre sa maîtrise technique au service du dialogue avec le client. Il doit le faire dans un langage que les clients comprennent et en l’occurrence, les connaissances techniques liées au print sont de plus en plus faibles chez ces derniers. C’est vrai sur les marchés de la communication, mais si l’on se place sur des marchés plus industriels comme ceux de l’étiquette, de l’impression fiduciaire ou encore de la notice pharmaceutique, qui se caractérisent par une technicité et des contraintes très fortes, les clients ont plutôt fait le chemin inverse. Les niveaux d’exigence sont également très élevés mais ils sont cette fois exprimés en des termes techniques très précis, avec parfois des demandes pointues qui sortent du cadre technique habituel. Là encore, le fabricant doit s’ajuster pour comprendre la demande au mieux et satisfaire les besoins exprimés. C’est particulièrement sensible dans le secteur du packaging, où les exigences liées au contact alimentaire sont en progression très nette. Cette montée globale des exigences doit donc autant aux attentes du client qu’à de nouvelles règlementations, mais ce qui est certain, c’est qu’en conséquence, l’imprimeur doit monter en puissance sur les notions de conseil et de services.
Est-ce que cette montée des exigences n’est pas parfois perçue comme injuste ou intenable, dans la mesure où les contraintes réglementaires peuvent être plus lâches à l’extérieur de nos frontières ? De même que les prix d’ailleurs : difficile de s’aligner sur les tarifs pratiqués en Europe de l’Est notamment…
Cette concurrence étrangère, effectivement souvent concentrée en Europe de l’Est, beaucoup des acteurs que nous avons rencontrés y sont confrontés. Mais tous ne sont pas en difficulté, loin de là. Il me semble important de souligner que certains s’en sortent même très bien ! Et ceux-là ont fait le pari de ne pas aller se battre sur des prix. Parce que c’est une bataille perdue d’avance. Mais cela soulève un problème plus structurel : beaucoup de petits acteurs, des TPE souvent, n’ont pas les moyens de se différencier et de conduire des stratégies ambitieuses en termes de repositionnement de leur offre. Ceux-là ont tendance effectivement à jouer sur les prix, parfois malheureusement jusqu’à descendre en-dessous de leur coût de revient. De fait, ils se mettent en difficulté et cela explique certainement beaucoup de disparitions. Ce réflexe est une menace aussi pour les autres : les prix cassés tirent tout le monde vers le bas. On doit travailler à optimiser ses coûts, bien évidemment, mais il faut que ce soit fait de pair avec la volonté de monter en compétences et de répondre au mieux à des besoins nouveaux. La meilleure façon de préserver ses marges est de monter en qualité et en spécificité. Cela peut venir du service ; c’est pour cette raison que beaucoup se développent sur l’aval, en faisant de la gestion de stock et de la logistique. Cela permet d’être meilleur sur les délais, les coûts de stockage ou les coûts d’intermédiaires, par exemple. Cela peut aussi venir d’un travail sur l’innovation, qu’elle soit technique, technologique ou centrée sur le produit, choix que l’on observe surtout chez les plus grosses PME. Il faut dans l’idéal pouvoir se permettre d’avoir une à trois personnes en charge de la R&D pour jouer les intermédiaires entre les commerciaux et les fabricants. Pour concevoir des produits nouveaux, il faut du temps de veille, de réflexion et de conception. L’innovation dépend aussi des marchés : des techniques de pliage ou de collage spécifiques, l’utilisation d’encres fonctionnelles, la création de puces RFID, l’assemblage de produits, etc. L’important, c’est de montrer aux clients qu’on est en capacité de leur proposer des choses qui entrent en résonance avec leurs besoins.
Est-ce qu’il n’est pas difficile d’établir des diagnostics d’entreprises pérennes quand la conjoncture est à ce point défavorable, avec notamment la flambée des prix des matières premières, mais aussi de l’énergie, le tout dans un contexte de conflit en Ukraine ?
On a effectivement vu monter tout cela quasiment en temps réel puisque la première entreprise que nous avons visitée, c’était en mai 2021. La dernière, c’était en juin 2022. C’était déjà assez clair en 2021, mais les choses se sont effectivement aggravées. Ce sont bien évidemment des préoccupations fortes, notamment sur le papier, pas seulement du fait de l’explosion des prix, mais tout simplement aussi pour des questions de disponibilité. C’est la raison pour laquelle, d’ailleurs, une des entreprises que nous avions prévu de visiter n’a finalement pas pu nous recevoir. Le contexte très instable dans lequel les entreprises évoluent depuis plus d’un an ne leur a pas permis de nous accorder ce temps. Ils étaient focalisés sur des impératifs de court terme, ce qui accentue un trait caractéristique de cette industrie, où les TPE sont surreprésentées : déjà en temps normal, il est difficile pour de petites structures de dégager ce temps de réflexion stratégique, c’est évidemment pire encore quand la conjoncture subit de tels aléas.
« Les Industries Graphiques peuvent se targuer d’être innovantes depuis plus de 400 ans. Il y aurait certainement beaucoup à faire pour que cela se sache enfin. »
Vous soulignez, hélas sans surprise, la dégradation de l’image du secteur, qui affecte durement son attractivité. L’influence des entreprises au cas par cas n’est-elle pas insuffisante pour infléchir sur ce phénomène ? Est-ce qu’il n’y a pas plutôt à mettre en œuvre ici des dynamiques collectives ?
Sur un plan micro, en effet, il semble compliqué pour une entreprise d’agir individuellement quand c’est l’image de tout un domaine d’activité qui est affecté. Néanmoins, ce que l’on constate et qui n’est pas forcément propre à ce secteur, c’est que les TPE et PME communiquent très peu sur leur marque employeur. Les sites Web des imprimeurs ont beaucoup progressé : ils sont passés de plaquettes techniques à des vitrines orientées clients, qui donnent à voir ce qu’ils sont capables de faire. En revanche, les sites en question ne s’adressent presque jamais à leurs candidats potentiels : qui nous recrutons, comment nous fonctionnons et quelle est « l’ambiance » de l’entreprise ? C’est comme si l’entreprise renonçait à véhiculer une image de ce qu’elle est ou de ce qu’elle veut être. Présenter son offre et ses produits ne suffit pas, il faut donner envie. C’est à mon sens un levier important et il est sous-exploité.
Par ailleurs, s’agissant d’un secteur très éclaté avec 4000 entreprises aux profils variés, il y a forcément un travail à faire à l’échelle collective. Un des problèmes, c’est que la filière graphique n’est pas complète en France : il n’y a presque plus de fournisseurs de matériel français et peu de papetiers. En France, l’industrie en général ne fait plus rêver et les métiers de l’impression – comme d’autres – en pâtissent. Pour les Industries Graphiques, cette image de secteur un peu « sale » et passéiste lui colle à la peau et en soi c’est assez injuste. J’ai été frappé du dynamisme avec lequel nombre d’entreprises s’attachent à innover : ce trait caractéristique des Industries Graphiques est mal connu et pourtant, il est très clair. Les innovations, qu’elles soient produits, techniques, RSE ou autres, sont aussi concrètes qu’elles sont finalement peu visibles. On a beaucoup parlé de la « Start-up Nation » ces dernières années, alors que finalement les Industries Graphiques peuvent se targuer d’être innovantes depuis plus de 400 ans. Il y aurait certainement beaucoup à faire pour que cela se sache enfin.
Enfin, si le numérique a dans un premier temps donné l’image d’un secteur d’activité à la fois plus moderne et plus écologique, les impacts qui lui sont attribuables sont de plus en plus évidents et partagés. De fait, l’on commence enfin à voir à quel point une communication « tout numérique » est plus nocive qu’un mix raisonné où le Print a encore sa place.
« Les exigences écoresponsables des donneurs d’ordre vont encore monter d’un cran et imprimer loin, mais de façon low cost, sera de moins en moins facile à assumer. »
Vous évoquiez le dynamisme des innovations, or il semblerait que les jeunes soient particulièrement sensibles à celles qui ont trait à l’environnement…
La thématique environnementale monte effectivement clairement, poussée notamment par la réglementation. Les imprimeurs avaient souvent déjà engagé des démarches, ils n’ont pas attendu la Loi AGEC. Il faut certainement encore pousser le curseur mais c’est là aussi un des coups à jouer par rapport à la concurrence internationale : les exigences écoresponsables des donneurs d’ordre vont encore monter d’un cran et imprimer loin, mais de façon low cost, sera de moins en moins facile à assumer. Par ailleurs, ce travail d’écoresponsabilité est beaucoup plus simple à conduire lorsque le donneur d’ordre et le fabricant sont en proximité : cela permet de discuter, d’échanger des idées et de progresser.
« Chez les entreprises qui comptent moins de cinquante salariés, on constate un déficit de stratégie tout simplement parce que cela prend du temps. »
Vous dîtes – je cite – que “le champ de la stratégie reste encore largement à labourer voire à défricher”. Comment expliquez-vous ce déficit global de vision et de réflexion stratégique ? Est-ce que ce n’est pas d’ailleurs paradoxal quand dans le même temps, vous dîtes constater un dynamisme très marqué en termes d’innovation ?
Il y a effectivement du dynamisme et des envies de faire. Mais globalement, chez les entreprises qui comptent moins de cinquante salariés, on constate un déficit de stratégie tout simplement parce que cela prend du temps. Lorsqu’on a un dirigeant, souvent seul, et des équipes de taille réduite, priorité est donnée à la production. La stratégie n’est pas délaissée par manque d’envie, mais parce qu’on éprouve des difficultés à appréhender le sujet : souvent, les dirigeants n’ont pas les outils et les connaissances pour se lancer, sauf à y passer beaucoup de temps. Or, ils n’en disposent pas. Cela n’empêche pas une forme de dynamisme, mais on n’est pas dans des stratégies construites. On observe plutôt des mouvements d’opportunités qui parfois, a posteriori, constituent des stratégies improvisées, presque non-intentionnelles. On suit son intuition. Beaucoup de petites entreprises se sont développées de cette façon, sans que ça ne soit forcément un problème. Mais cette façon de fonctionner est rendue beaucoup plus simple lorsque l’on se situe dans des marchés en croissance. A l’inverse, quand on est positionné sur des marchés en contraction, arrive toujours le moment où il faut faire des choix et prendre des décisions. Soit on repense son parc machines et on investit, soit on cherche à étendre son offre, soit on se réorganise etc. Mais un investissement insuffisamment préparé peut coûter cher… Il faudrait donc aller vers plus de vision stratégique à moyen terme. Les entreprises qui s’en sortent le mieux aujourd’hui sont celles qui ont un positionnement clair, avec des capacités de production parfaitement adaptées à leur offre. Soit elles se sont spécialisées sur un marché, soit elles maîtrisent tout particulièrement une technologie, soit elles s’adressent à un secteur spécifique etc. De fait, elles sont beaucoup mieux identifiées auprès de leurs clients. Ce travers peut même parfois s’observer chez de grands groupes récemment constitués, justement parce qu’ils n’ont pas eu le temps de de se redéfinir. Mais je pense qu’il faut voir cela positivement : c’est la preuve qu’il existe un potentiel de développement non-exploité. Certains s’en sortent finalement sans vision stratégique très claire, de fait peut-on considérer que ces entreprises n’usent pas de leur plein potentiel et pourraient performer encore plus.
Vous êtes parfois sévère quant au défaut de culture managériale constaté dans l’entreprise. Est-ce que c’est d’ailleurs une cause – directe ou indirecte – du déficit de vision stratégique dont vous venez de parler ?
La stratégie et le management relèvent effectivement plutôt de la même sphère, mais il faut faire une distinction à mon avis : la stratégie concerne plutôt des réflexions quant aux évolutions qu’il faudrait impulser à l’entreprise. Le management, au sens où nous l’entendons ici, sera plus tourné sur l’animation interne.
Vous parlez même de “solitude”, qui est un terme qui revient plusieurs fois dans l’étude. A la fois celle du dirigeant, mais aussi celles des collaborateurs en général. Est-ce que cela trahit selon vous un fonctionnement encore très vertical, voire mutique, en interne ?
On retrouve effectivement souvent cette solitude à la tête des entreprises et c’est seul que le dirigeant prend les décisions stratégiques. Si l’on descend un peu et que l’on parle de management d’encadrement pour conduire l’animation des équipes, ce sont en effet des éléments souvent défaillants ou faiblement développés. Il y a là une raison certainement culturelle : c’est un secteur encore très ancré dans la technique. On a vu beaucoup d’industries qui se sont modernisées ces vingt dernières années aller sur des approches de type lean management [méthode de gestion qui vise à corriger les dysfonctionnements et à réduire les gaspillages en associant fortement les opérateurs avec un « management participatif », NDLR] et travailler sur leur cohérence collective. Dans les Industries Graphiques, on l’a finalement peu fait. Nous avons même été surpris d’entendre, de la part de l’encadrement intermédiaire, des termes qu’on ne trouve plus ailleurs. On nous a par exemple parlé dans certains cas de « contremaîtres », là où aujourd’hui on parle communément d’agents de maîtrise. Or, le contremaître reste justement très tourné sur la maîtrise technique. Ceux qui prennent des responsabilités dans les ateliers sont toujours les meilleurs techniciens : ils prennent du plaisir dans le réglage de leurs machines et sont soucieux d’optimiser la qualité de production. C’est bien souvent grâce à eux que certaines entreprises bénéficient d’une image d’excellence, mais ils sont souvent en difficultés sur le management : comment je transmets ? Comment j’accompagne ? Comment je donne à voir l’activité de l’entreprise ? Comment je propose des retours d’expérience et des analyses de situation quand on a des erreurs à répétition ? Sur certaines de ces questions, ils ont tendance à se focaliser sur la technique alors qu’il faudrait aller plus loin et interroger les modes de fonctionnement, comprendre comment les choses se passent entre les départements prépresse et les ateliers, puis entre l’impression et la finition etc. C’est de cette façon que l’on se rend compte que parfois, les informations sont tout simplement mal transmises. Dans certains cas, c’est la façon dont on note et collecte les informations qui peut induire en erreur et générer des dysfonctionnements. Le management, c’est bien évidemment cela, mais c’est aussi donner des perspectives et donner à voir ce que pourra être l’entreprise demain. C’est d’ailleurs là un point essentiel en termes d’attractivité : les jeunes ont besoin d’un projet dans lequel se projeter, on ne peut pas se contenter de leur attribuer un poste. Cela veut dire qu’il faut leur ouvrir les sphères du développement et de la stratégie de l’entreprise, quand aujourd’hui on a l’impression qu’elle n’appartient guère qu’à un dirigeant esseulé. C’est quelque chose qui nous a vraiment surpris : quand on discute avec les salariés en ateliers, on est face à d’excellents techniciens, mais qui ont souvent une très faible connaissance des marchés sur lesquels ils sont positionnés. Pire encore, ils sont assez fréquemment ignorants de la situation de l’entreprise elle-même. Il y a un manque clair de culture économique, preuve que ce n’est pas un sujet suffisamment abordé et partagé en interne. Parfois on constate même des manquements très prononcés en termes de contrôles de gestion : on en sait pas dire ce qui fait gagner ou perdre de l’argent à l’entreprise. Sur ces points, c’est à l’encadrement d’être plus présent, car on ne peut pas prendre de décisions éclairées sans se comprendre soi-même.
« Quand la circularité de l’information entre le prépresse, les ateliers et la finition ne consiste qu’à faire transiter des dossiers, on ne se parle pas vraiment. »
Est-ce que les collaborateurs se plaignent de ce que vous décrivez, à savoir une forme d’invisibilisation de la situation de l’entreprise et de ce vers quoi elle va ?
Ce n’est pas forcément un malaise et ce n’est en tout cas pas vraiment exprimé comme tel. Il y a en revanche clairement de l’incertitude alors que paradoxalement, dans les petites entreprises, il y a une grande proximité avec le patron. Mais il se noue en conséquence une confiance un peu aveugle : les collaborateurs ont conscience que le secteur est en tension sur ses marchés historiques, mais on se dit que le dirigeant saura prendre les bonnes décisions. Certains regrettent quand même qu’il n’y ait pas plus régulièrement des réunions destinées à faire le point, pour répondre à cette simple question : où en est-on ? Encore une fois, on est obligé d’observer que les entreprises qui s’en sortent le mieux sont parvenues à créer un véritable collectif, avec du liant entre les différents services. Pour faire très simple, quand la circularité de l’information entre le prépresse, les ateliers et la finition ne consiste qu’à faire transiter des dossiers, on ne se parle pas vraiment.
Parmi les motifs d’optimisme, vous notez que les initiatives RSE sont souvent l’occasion de repenser l’organisation de l’entreprise à la racine. Certains considèrent que c’est pourtant un “luxe” que l’on peut se permettre lorsque les fonctions business pures sont avantageusement assurées. Est-ce qu’il ne faudrait pas pourtant porter les réflexions RSE ailleurs que dans les entreprises déjà “premières de la classe” ?
Il est vrai qu’il y a encore ce côté « premier de la classe » chez les entreprises les plus investies en RSE, mais dans la mesure où les attentes des clients en la matière ne font que monter, ça ne peut pas rester en l’état. Le risque à ne pas y aller est clair : on peut perdre des marchés ! Il faut redire que les donneurs d’ordre eux-mêmes ont de plus en plus de pression sur cette question et il y a une attente qui va continuer de grandir. Heureusement, le secteur peut capitaliser sur un travail qui a été déjà largement engagé – notamment via Imprim’Vert – mais il va falloir aller plus loin. Sur cette thématique RSE, c’est Print’Ethic qui tient la corde aujourd’hui et nous avons vu quelques entreprises qui s’y sont lancées. L’approche est intéressante puisque l’engagement est progressif et dimensionné aux moyens de l’entreprise, qui pourra entamer une démarche « à sa main ». C’est encore trop tôt pour tirer des conclusions, mais c’est une piste prometteuse.
Si vous deviez résumer en quelques mots l’enseignement principal de votre étude…
Le diagnostic que nous avons établi fait certes ressortir un certain nombre de points noirs et de faiblesses, notamment sur les notions de stratégie et de management. Mais je suis plutôt optimiste pour le secteur : il faut y voir un potentiel de progression énorme. Sur des marchés tendus et fortement perturbés depuis quinze ans, la révolution numérique étant passée par là, on voit des entreprises capables de s’en sortir sans même avoir abattu toutes leurs cartes et joué tous leurs atouts. En travaillant à renforcer le management, améliorer la cohérence organisationnelle en interne, construire des collectifs soudés, faire de l’amélioration continue, consolider la dimension ‘conseil & services’, faire de la R&D pour mieux préparer ses investissements et en déduire des solutions commerciales viables et, enfin, travailler son positionnement sur le marché en développant une réelle vision stratégique avec une forte identité de marque, il y aurait de quoi faire émerger de vrais champions économiques. Cette marge de progrès existe et il faut s’en réjouir.







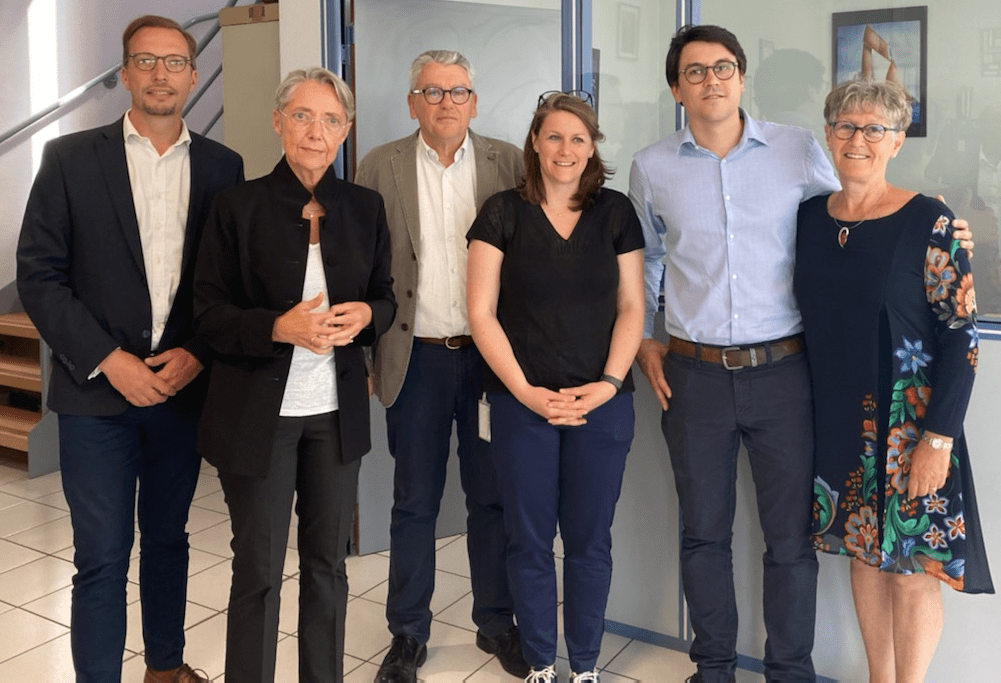

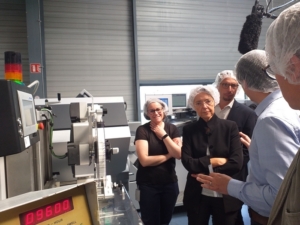
![[UNIIC]](https://uniic.org/wp-content/uploads/2015/11/uniic-logo-top-120.png)