Noémie Regardin – “Il faut amener les jeunes dans les ateliers”
Cet article, publié ici en avant-première, sera au sommaire du magazine Acteurs de la Filière Graphique n°152.
C’est un petit crève-cœur, mais pour la première fois depuis de nombreuses éditions, Acteurs de la Filière Graphique n’a pas pu couvrir les Finales nationales des Worldskills 2025, qui se sont tenues à Marseille en octobre dernier. Qu’à cela ne tienne, quelques semaines après sa victoire dans la catégorie Imprimerie, nous nous sommes entretenus avec Noémie Regardin, 23 ans aujourd’hui, qui s’était déjà distinguée en 2023 avec une remarquable médaille d’argent. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle a de la suite dans les idées…

Noémie Regardin (représentante des Pays de la Loire), entourée de Killian Fehringer (à gauche, Auvergne-Rhône-Alpes), lauréat 2023, et Tom Krzciuk-Paillot (à droite, Nouvelle-Aquitaine).
Félicitations Noémie pour cette victoire. On a l’impression qu’après ta très belle médaille d’argent en 2023, tu n’étais pas rassasiée. Est-ce que tu as su tout de suite que ce n’était pas suffisant et que tu allais retenter ta chance en 2025 ?
Après les finales 2023, je n’étais plus censée pouvoir concourir à nouveau puisque je dépassais l’âge requis. Mais quelques mois après ma médaille d’argent, j’ai appris qu’ils avaient repoussé la limite d’âge en question et on s’est justement dit avec Killian [Killian Fehringer, lauréat des Finales nationales 2023, NDLR] que c’était l’occasion de refaire la compétition. Il est en tout cas certain que dès que j’ai su que je pouvais tenter à nouveau d’aller chercher l’or, je ne me suis même pas posé la question : il était évident que j’allais réessayer. Une médaille d’argent ne me suffisait pas.
C’est une petite consolation après l’exclusion des métiers de l’imprimerie des compétitions internationales ?
Oui, même si j’ai l’impression que ce sont les métiers qui ont été exclus des compétitions mondiales et/ou européennes qui ont bénéficié de ce rehaussement de l’âge limite de participation. Parce qu’il ne faut pas se cacher que nos métiers peinent un peu plus à avoir des candidats. Il faut se rendre compte que d’autres métiers comme les paysagistes ou les coiffeurs par exemple, ont même des présélections avant les épreuves régionales, tant les candidats sont nombreux.
La France figurait parmi les nations favorites dans le secteur graphique et elle avait plutôt tendance à montrer l’exemple. L’imprimerie ne figure plus parmi les métiers à l’échelon international parce que le seuil de 14 pays participants peinait à être atteint…
Oui, on a le sentiment de faire le maximum pour porter nos métiers en France en motivant d’autres jeunes et c’est forcément rageant de se dire qu’on rate les compétitions internationales parce que d’autres pays ne fournissent plus ces efforts…
“L’impression numérique a pris encore plus d’importance.”
Revenons à ces Finales nationales. Tu avais l’expérience de l’édition 2023, est-ce que l’édition 2025 t’a semblé similaire ou est-ce qu’au contraire tu as senti une évolution dans l’approche des épreuves ?
C’était plutôt différent sur cette édition, pour plusieurs raisons. Déjà j’ai travaillé avec deux experts qui ont deux manières distinctes de penser les épreuves : Dorothée Bouchend’Homme, qui a pris la suite de Dominique Gendre, et Thierry Mack. Et puis surtout, l’impression numérique a pris encore plus d’importance. On m’a dit que c’était déjà le cas en 2023 en comparaison des éditions précédentes, mais cette année c’était encore plus flagrant : nous avons eu cinq épreuves relatives à l’impression numérique et une épreuve offset, qui a dû être annulée en raison d’une panne. C’était certainement la nouvelle la plus triste pour moi, parce que même si je suis tout à fait ouverte au numérique – qui demeure un complément nécessaire – le cœur de nos métiers, ça reste l’offset. Et pour le coup, j’avais eu le temps de faire cette épreuve, la panne est survenue juste après mon passage et ça a été une vraie déception.
Tu avais prévu cette mise en avant de l’impression numérique ? Est-ce que tu t’y étais préparée ?
Oui, au cours d’un stage préparatoire chez Konica Minolta, on avait effectivement anticipé l’importance grandissante de l’impression numérique dans les épreuves et je m’y étais préparée. Il faut dire qu’en revenant sur les intitulés des épreuves des dernières éditions, on voyait bien l’accent mis progressivement sur l’impression numérique. Je dois beaucoup à mon coach, Philippe Tanguy [formateur impression chez Grafipolis, NDLR], qui m’a énormément apporté à la fois sur le plan technique mais aussi sur le plan de la gestion du stress. Et la chance que j’avais, c’est que son oncle a une imprimerie en Bretagne, l’Imprimerie Tanguy située à Pont-l’Abbé. Il se trouve qu’elle est justement équipée d’une Presse Konica Minolta et même si ce n’est pas le même modèle qu’en compétition, j’ai pu me faire la main [RIRES].
Tu es conductrice offset chez Atlantique Impression. Comment ton parcours a été accueilli dans l’entreprise pour laquelle tu travailles ?
J’avais fait un premier stage chez eux dans le cadre d’un BAC Pro en communication visuelle et c’est mon patron qui est revenu vers moi et m’a démarchée suite à ça. C’est ce stage qui m’avait permis de me rendre compte que j’étais davantage attirée par la production et que j’avais envie d’être en atelier, pas devant des ordinateurs. C’est ensuite toujours lui qui m’a poussée à faire les Meilleurs Apprentis de France et quand je lui ai parlé du concours, il m’a soutenue de façon inconditionnelle. Nous sommes une toute petite entreprise – nous ne sommes que trois – et c’est sûr que mon parcours au Worldskills a été une chance pour tout le monde.
“Dans de toutes petites entreprises avec moins de moyens, on doit développer son savoir-faire autrement et j’en suis super fière.”
Ton profil est intéressant à double titre puisque tu es la première fille à remporter le concours, ce qui tend à démontrer que le métier est certainement en train de se féminiser. Par ailleurs, le fait que tu travailles dans une TPE doit également rappeler que l’essentiel du tissu industriel français est constitué de ces toutes petites structures, où l’on trouve donc de grands talents…
Oui, je suis d’accord avec ça et j’ai même un exemple tout bête à mettre en avant. Il se trouve que la dernière épreuve – celle de la recherche de teinte – était la seule où tous les candidats passaient en même temps, alors que nous alternions les épreuves sur les machines. Nous étions côte à côte à rechercher une teinte avec du cyan/magenta/jaune et la consigne était claire : nous n’avions pas le droit d’utiliser un spectrophotomètre. Il fallait travailler à l’œil et demander à mesurer le delta E [soit la mesure de la différence visuelle entre deux couleurs, dans un espace colorimétrique perceptuellement uniforme, NDLR] une fois que nous considérions que c’était OK. J’ai obtenu un delta E de 1,11 et tous les jurés étaient surpris que je tombe si proche, juste à l’œil. Certains m’ont demandé suite à ça quel était mon secret et la vérité, c’est juste que je travaille depuis cinq ans sans spectro’ [RIRES]. Parce que parfois, dans de toutes petites entreprises avec moins de moyens, on doit développer son savoir-faire autrement et j’en suis super fière.
Tu ne peux donc plus reconcourir, mais est-ce que tu as gardé contact avec d’autres compétiteurs, experts, coaches etc. ? Voire, est-ce que tu envisages d’intégrer un jour le staff de l’équipe de France, pour devenir coach toi-même, par exemple ?
Oui, totalement ! Quand on rentre dans la famille Worldskills, on n’a pas du tout envie d’en sortir. Il y a même un contrecoup quand la compétition s’arrête : on sait qu’on ne va pas pouvoir la refaire et personnellement, je me suis toujours dit que je voulais garder un pied dedans. Ça commence en effet par nouer des relations de long terme avec les gens que l’on rencontre, dont nos « adversaires ». Avec Killian on a gardé un très bon contact et ça concerne même plus globalement toute l’équipe régionale notamment. Quant aux Worldskills et la suite que j’imagine possible, j’aimerais d’abord commencer en tant qu’ambassadrice pour témoigner et mettre en avant le concours. Et petit à petit, je verrai comment je peux essayer d’intégrer les jurés régionaux.
“Je suis bien placée pour dire que c’est souvent en étant face aux machines que l’on se rend compte que ça nous plaît…”
Il y a de vifs débats qui secouent nos métiers sur la question de l’attractivité du secteur graphique. Comment est-ce que tu perçois la difficulté croissante des entreprises à attirer et recruter ?
J’admets que pour ma part, je ne me reconnais pas toujours dans ce qui attire les gens de mon âge. J’ai un compagnon qui est agriculteur et je pense que lui comme moi, on a une vraie sensibilité pour l’artisanat et les métiers de mains. C’est vrai que c’est un trait de caractère qu’on retrouve peu chez les jeunes que l’on peut côtoyer. Le fait que le numérique commence à s’imposer, y compris dans nos métiers, à la fois ce n’est pas forcément ce que je préfère – comme je l’ai déjà dit, je suis plus sensible aux techniques traditionnelles – mais c’est aussi sûrement l’opportunité de donner une image plus moderne et attractive de nos métiers. L’autre enjeu, je pense, c’est d’arriver à créer des rencontres. Je suis bien placée pour dire que c’est souvent en étant face aux machines que l’on se rend compte que ça nous plaît… Je sais que c’est plus facile à dire qu’à faire, mais il faut essayer de créer ces moments en amenant les jeunes dans les ateliers. C’est là que peuvent se produire de belles surprises, parce que c’est un métier de passion. Mais il faut le vivre pour le comprendre, en parler ne suffira jamais.
Et l’Intelligence Artificielle ? Comment est-ce que tu imagines l’avenir de ton métier au regard de ce qui se passe autour de l’IA aujourd’hui ? Est-ce que tu te sens directement concernée par les impacts que cela peut générer sur la façon de produire ?
Il est certain que le prépresse est déjà complètement impacté. On voit de plus en plus de clients utiliser l’IA pour des créations de fichiers, mais j’admets que même pour quelqu’un de jeune comme moi, on a du mal à réaliser exactement ce qui va se passer. Ce que je peux dire, c’est que je nous imagine mal y échapper : ce n’est pas une perspective qui me rend très enthousiaste, mais je me fais à l’idée que nos métiers composeront avec l’IA également, jusque dans les ateliers de production. Mais encore une fois, je fais le parallèle avec le développement des technologies numériques dans nos métiers : c’est une façon de faciliter le travail de production et on a peut-être besoin de se rendre plus accessibles.


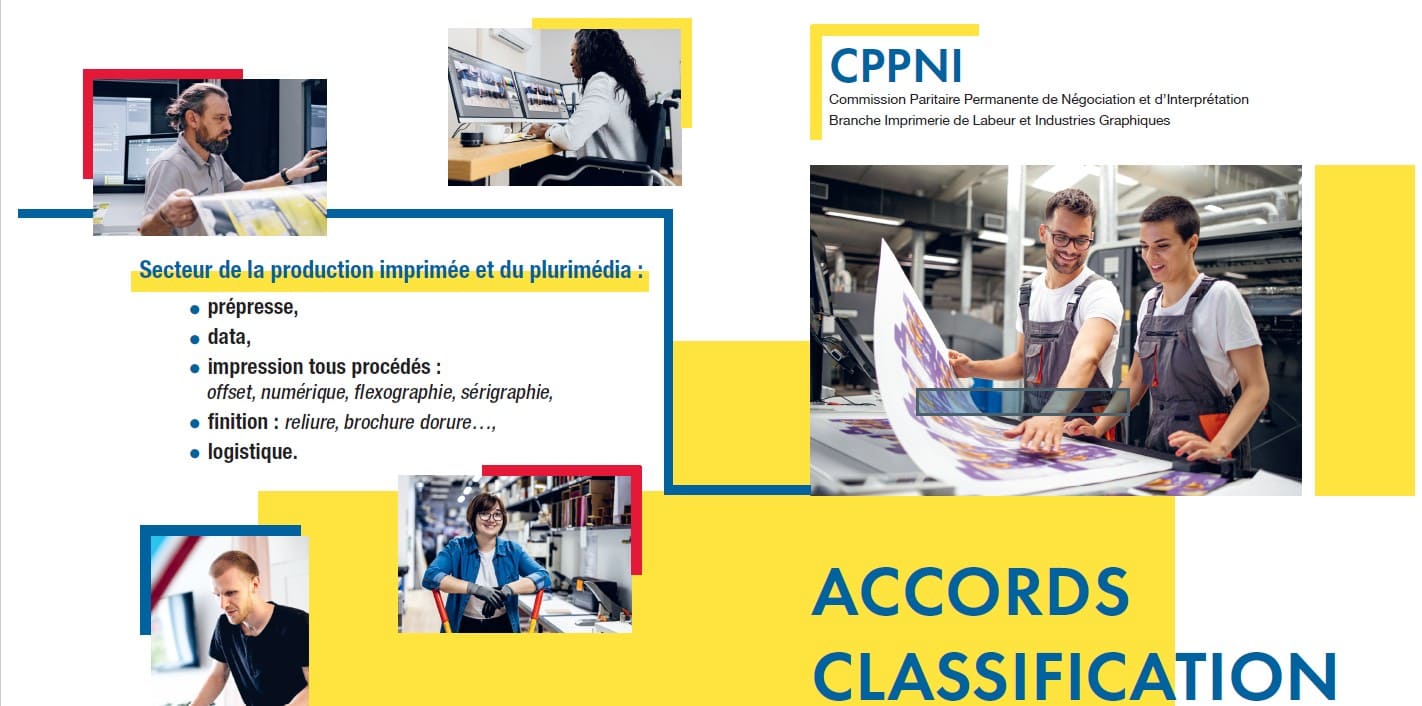

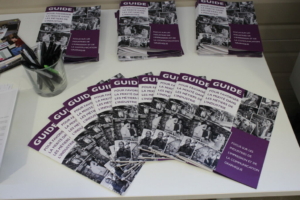

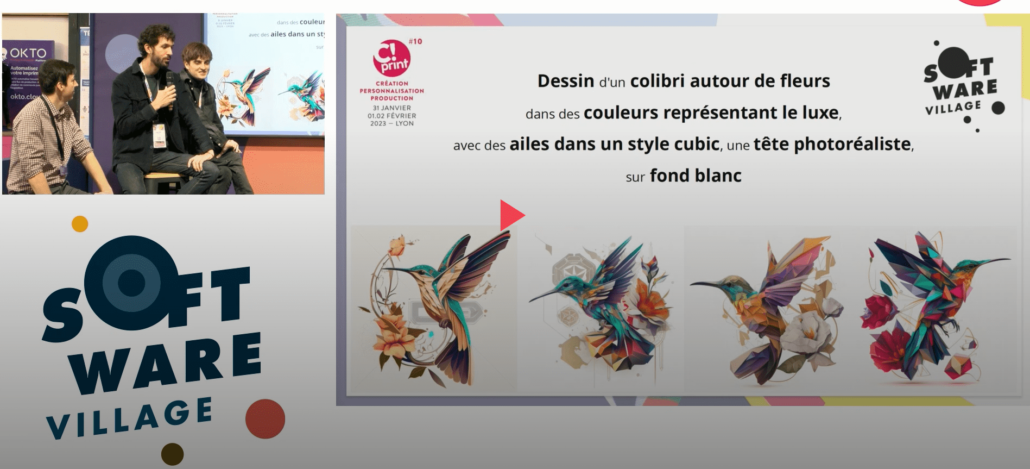



![[UNIIC]](https://uniic.org/wp-content/uploads/2015/11/uniic-logo-top-120.png)