Lles Industries Graphiques disposent désormais d’un label RSE dédié – Print’Ethic – initié par l’UNIIC, géré par l’IDEP et élaboré avec l’appui de l’AFNOR.
Entretien avec Valérie Bobin Ciekala (IDEP), Directrice des Opérations et du développement de la RSE sectorielle, pour mieux comprendre les ressorts, opportunités et enjeux d’une démarche de temps long, qui se veut plus souple et accessible que nombre de labels déjà existants dans ce domaine…

Une enquête, lancée l’année dernière sous forme de questionnaire, devait servir à élaborer une stratégie RSE sectorielle…
Le questionnaire a permis un retour à la fois des imprimeurs, des représentants des salariés et des parties prenantes externes (clients, écoles, fournisseurs, ONG, pouvoirs publics…) sur une question simple : sur quels sujets le secteur doit-il prioritairement travailler ? Cela nous a permis de voir quels enjeux apparaissaient importants à la fois pour les imprimeurs – pour leur pérennité, pour leur développement etc. – et aussi pour ces parties prenantes externes, notamment les clients, qui sont les premiers à inciter leurs imprimeurs à adopter des démarches RSE. Leurs exigences en la matière devraient d’ailleurs croître dans les années à venir…
L’analyse du comité de pilotage, multi-parties prenantes lui aussi, a permis de sélectionner 15 enjeux : 3 qui étaient à travailler sur le plan collectif au niveau de la branche et 12 qui constituent une sorte de feuille de route pour les entreprises. On en trouve dans le domaine économique, social, environnemental et dans le domaine de la gouvernance de l’entreprise. Tous les champs de la RSE sont couverts. L’idée était en effet de partir de la définition très large de la RSE de l’ISO 26000, pour resserrer sur des points clés pour l’avenir du secteur, avec l’idée de voir là où nous avions de vrais progrès à faire.
Quels sont donc ces 12 enjeux ?
- Définir la politique de responsabilité sociétale de l’entreprise, la piloter grâce à une organisation pérenne.
- Définir une stratégie de positionnement et de développement de l’entreprise à 3/5 ans.
- Intégrer une culture de l’innovation, dans les produits, les services, l’organisation de l’entreprise.
- Identifier les parties prenantes prioritaires de l’entreprise et dialoguer avec elles.
- Favoriser le développement d’un dialogue social de qualité.
- Identifier les risques de l’entreprise et prendre des mesures de prévention.
- Investir dans les compétences des salariés, élément-clé de compétitivité et de sécurisation des parcours professionnels.
- S’impliquer pour améliorer la connaissance et l’attractivité du métier et pour former des professionnels qualifiés.
- Réduire l’impact environnemental de la production à travers notamment une optimisation du volume et de la qualité des matières premières utilisées.
- Réduire les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d’énergie.
- Mettre en œuvre le Règlement Européen sur la protection des données.
- Promouvoir la RSE chez les fournisseurs et sous-traitants.
Une fois ces 12 enjeux définis, nous nous sommes demandé comment accompagner les entreprises pour proposer quelque chose de motivant et structurant. Nous avions d’ailleurs demandé dans le questionnaire quels pourraient être les freins ou les leviers de motivation pour susciter (ou au contraire décourager) cet engagement. La première motivation était très claire : c’était d’avoir un label RSE reconnu par les clients. C’est également apparu comme un facteur de motivation pour les salariés, puisque c’est une façon de reconnaître les efforts accomplis par les équipes en interne, jusque dans la manière de travailler. Nous nous sommes alors demandé s’il fallait partir sur un label existant : le label Lucie ? Les labels proposés par des organismes comme l’AFNOR ? Etc. Mais ces labels portent sur tout le champ de la RSE, alors que nous venions justement de définir plus finement 12 enjeux sectoriels… Par ailleurs, ces labels sont souvent complexes et coûteux à mettre en place pour des petites entreprises. Nous sommes donc restés sur l’idée de construire notre propre label encouragés par l’expérimentation publique lancée par la plateforme RSE de France Stratégie, qui vise à expérimenter des labels RSE sectoriels. L’objectif, c’est de promouvoir la RSE dans les TPE & PME. Cela correspondait très exactement à ce que nous étions en train de faire, nous avons donc décidé de porter un dossier de candidature, en se disant que c’était pour nous un gage de qualité au vu du cahier des charges, à la fois structuré et ambitieux. C’est une façon de montrer le sérieux de notre label, tout en le rendant plus visible. Participer à cette expérimentation permet aussi de voir ce que font les autres et de bénéficier d’expériences croisées. Nous avons donc travaillé, début 2018, à un référentiel de labellisation autour des 12 enjeux. Le cahier des charges pour l’expérimentation imposait que l’on fasse évaluer notre référentiel par un organisme externe expert en RSE. Nous avons donc choisi de travailler avec l’AFNOR, qui a établi une analyse de robustesse/conformité par rapport aux grandes lignes de l’ISO 26000, validant notre approche sur ces différents points. Nous avons donc été retenus, avec 11 autres secteurs expérimentant eux aussi des labels sectoriels.
Comment s’organise le processus de labellisation ?
Pour que la démarche reste accessible aux petites entreprises, nous avons misé sur la progressivité.
Le label est divisé en quatre niveaux, en fonction du nombre d’enjeux abordés par l’entreprise. Chaque entreprise aura l’obligation de monter d’un niveau tous les trois ans. Pour obtenir le premier niveau, il s’agira dans un premier temps d’établir un plan d’action précis sur trois ans portant sur trois premiers enjeux. Au bout de ces trois ans, l’entreprise devra être en mesure de montrer qu’elle a mis en œuvre tout ce qui est exigé dans le référentiel de labellisation, et préparer un plan d’action sur trois autres enjeux sur les trois années suivantes. Ainsi de suite jusqu’au niveau 4.
Le label est décerné par un comité d’attribution multi-parties prenantes, constitué de 4 collèges : les organisations professionnelles, les syndicats de salariés, les parties prenantes externes et les experts RSE. C’est ce comité d’attribution qui validera les différents niveaux, sur la base d’un dossier fourni par l’entreprise, laquelle devra produire les documents qui prouveront les résultats de son engagement.
Un label de niveau 4 peut donc exiger 12 ans de travail ?
Oui, cela peut effectivement porter sur 12 ans. Ça peut paraître long, mais il faut bien comprendre que c’est l’entreprise elle-même qui choisit dans quel ordre elle va traiter les sujets qui la concernent, selon ses priorités [mis à part les enjeux 1 (organisation de la fonction RSE dans l’entreprise) et 7 (investissement dans les compétences) qui sont imposés pour le niveau 1, et l’enjeu 2 (définition d’une stratégie de l’entreprise) imposé au niveau 2]. Elle peut éventuellement en rajouter, si jamais elle se rend compte que ses clients ont des demandes spécifiques en la matière. Après, toutes les entreprises n’iront pas forcément au bout, mais elles auront le bénéfice du travail engagé et auront pu progresser sur les thématiques prioritaires choisies.
Qu’en est-il d’éventuelles entreprises qui auraient déjà un « temps d’avance » en matière de RSE ? La procédure peut-elle être accélérée ?
Oui, d’autres pourront aller plus vite et rentrer directement en niveau 3, par exemple, si leur politique RSE est déjà suffisamment développée. Il est également possible de monter d’un niveau plus vite, sans nécessairement attendre trois ans, si le travail de développement RSE en interne est plus rapide et efficace que la moyenne. Mais ce ne seront pas forcément les cas les plus fréquents : l’idée est d’amorcer un travail de temps long. Encore une fois, c’est une démarche en forme d’engagement. L’idée de progressivité va dans le sens de l’accessibilité du label, qui était primordiale pour nous. Nous voulions que ce soit également accessible d’un point de vue financier : il n’y aura pas à payer d’auditeurs externes, sauf au niveau 4, puisque le processus fonctionne par dossiers remis par l’entreprise elle-même. Mais plus encore, nous voulions donner un maximum d’outils d’accompagnements aux référents RSE des entreprises engagées dans le processus de labellisation.
Quel sera le rôle du référent RSE ? Comment se doter d’un(e) responsable compétent(e) en la matière, a fortiori quand on est une petite structure ?
Ce référent RSE, désignée par l’entreprise, est le pivot du système :
– Nous allons le former. Un appel d’offres est en cours auprès de différents cabinets experts pour proposer une formation initiale de référents RSE de quelques jours, étalée sur 6 mois, qui va lui permettre de faire le juste diagnostic de son entreprise, voir quels sont les points prioritaires sur lesquels travailler, penser son plan d’action, commencer à sensibiliser le personnel en interne, commencer à communiquer en externe etc. Une fois le référent nommé, formé et quand il aura formalisé le plan d’action RSE sur les premiers enjeux, il sera en mesure de présenter un dossier pour demander le niveau 1 de labellisation. Si le dossier est validé, l’entreprise a trois ans pour mettre en œuvre son plan d’action, sous l’impulsion du référent RSE.
Le référent ne sera pas laissé seul pour autant : il fera partie d’un réseau des référents RSE que nous nous chargerons d’animer et qui proposera à la fois des réunions physiques, des web-conférences, des formations à distance etc. Il sera tenu, via le référentiel du label, de participer à 4 webinaires par an ainsi qu’à une réunion physique. Nos chargés de mission IDEP seront également là, pour être en accompagnement expert sur le volet « compétences », pour aider à monter les dossiers, pour aider à identifier d’éventuels freins et contribuer à trouver des solutions.
Toute la philosophie du label repose là-dessus : c’est un accompagnement fort par la branche d’une action de transformation qui sera portée en interne, dans l’entreprise, par le dirigeant et les salariés. Limiter les interventions de consultants externes permet de mieux s’approprier la démarche. Cela demande certainement du temps, ce qui est une forme d’investissement, mais pas d’argent stricto sensu…
A noter enfin que si un événement dans la vie de l’entreprise – départ du référent RSE, rachat, réorganisation ou quoi que ce soit qui mobilise beaucoup de temps et d’énergie – vient entraver la démarche de transformation RSE, l’entreprise peut demander une année supplémentaire au comité d’attribution pour atteindre tel ou tel niveau. Ce sera évidemment accordé si la demande se justifie.
Comment s’assurer que le label sera perçu comme un label crédible, notamment par les clients ?
La reconnaissance du label est nécessaire, c’est pourquoi nous l’avons construit avec les parties prenantes externes, de sorte à ce que leurs attentes fassent partie de l’ADN de Print’Ethic. Par ailleurs, nous nous sommes basés sur la norme ISO 26000 qui est une référence en matière de RSE, le label a été évalué positivement par l’AFNOR et il est inscrit dans l’expérimentation publique dont nous parlions. On a donc là toutes les garanties de sérieux et de qualité autour de cette démarche. D’autant que tous les deux ans, l’AFNOR fera un audit du fonctionnement de tout le système de labellisation. Ils vérifieront les compte-rendu en comités d’attribution, feront éventuellement quelques visites aléatoires dans des entreprises labellisées etc. Le but pour eux est de s’assurer que l’attribution du label correspond bien à la réalité. L’intérêt pour nous est de montrer que la démarche est sérieuse et solide.
Entre deux labellisés, il peut y avoir de grandes différences en termes d’avancement dans la démarche. Comment les distinguer ?
Le logo Print’Ethic est construit de manière à ce que l’on voit les différents niveaux de progression, matérialisés par des ronds colorés quand ils sont atteints, vides quand ils restent à atteindre, de sorte à ce que l’on fasse tout de suite la différence entre un labellisé de niveau 1 et un labellisé de niveau 4. Mais la question des niveaux vaut surtout dans le cadre des relations avec un client, en fonction par exemple de ses attentes, mais pour le grand public et pour communiquer autour de la philosophie du label, ça n’a pas forcément grande importance. Le label sert surtout à certifier l’engagement de l’entreprise dans une démarche d’amélioration continue en matière sociétale.
Maintenant, à nous de motiver les entreprises à s’engager avec pour nous un double travail de communication, à la fois auprès des entreprises et auprès des parties prenantes externes, notamment les clients. Il faut commencer par dénicher des entreprises qui voudraient être pionnières sur ces sujets, pour expérimenter la démarche et assez vite, ce label devrait être regardé avec intérêt par les clients. De là naîtra une motivation commerciale à aller vers Print’Ethic. Il ne faut pas se cacher que pour l’instant, la demande des clients pour des prérequis RSE est rare. Les exigences sont encore très centrées sur l’environnement. Mais cela devrait changer dans la mesure où la réglementation qui pèse sur les clients eux-mêmes les oblige à mettre en place des démarches d’achats responsables et de se préoccuper de ce que font leurs fournisseurs en matière de RSE. Et puis forcément, plus nous aurons d’entreprises engagées dans la démarche, plus le label aura un attrait pour les clients…
Quelles sont les bonnes raisons de s’engager dans une telle démarche ?
Le chef d’entreprise qui veut s’engager dans la démarche doit déjà montrer une réelle motivation, parce que c’est un processus de transformation global. Ce n’est pas quelque chose qu’on fait à la marge. C’est professionnaliser et structurer sa manière de travailler avec des principes sociétaux bien ancrés dans le fonctionnement de l’entreprise. Il devra ensuite désigner un référent RSE qui, idéalement, ne sera pas lui. Ce n’est pas toujours facile dans les plus petites structures de trouver une autre personne que le dirigeant pour occuper ce rôle, mais dans la mesure du possible, il faut diffuser la philosophie de la démarche au reste des équipes et donc, responsabiliser ses équipes autour du projet. Et puis plus prosaïquement, on sait que le chef d’entreprise a souvent un emploi du temps compliqué… Le rôle du référent étant de « pousser », il faut quelqu’un de disponible.
Les dirigeants ne doivent surtout pas aborder cette démarche comme une « bonne action », accessoire par rapport au fonctionnement de l’entreprise. S’engager dans Print Ethic, c’est d’abord travailler à la performance de l’entreprise. Une étude statistique élaborée par France Stratégie comparait par exemple les résultats financiers d’entreprises qui ont engagé une démarche RSE structurée, à d’autres qui n’ont encore rien fait en la matière. Le différentiel de performance entre les deux, à la faveur des premières citées, est de 13 %, ce qui est loin d’être négligeable. Tel gain n’apparaît évidemment pas immédiatement, c’est quelque chose qui s’obtient à moyen terme, mais cela mérite réflexion… Voire engagement.
Nous invitons les entreprises intéressées à s’engager dans le processus d’expérimentation/labellisation auprès de Valérie Bobin Ciekala, IDEP, Directrice des Opérations et du développement de la RSE sectorielle (v.bobin@com-idep.fr) ou Matthieu Prevost, Responsable environnement pour l’UNIIC et animateur national de la marque Imprim’Vert (matthieu.prevost@uniic.org).




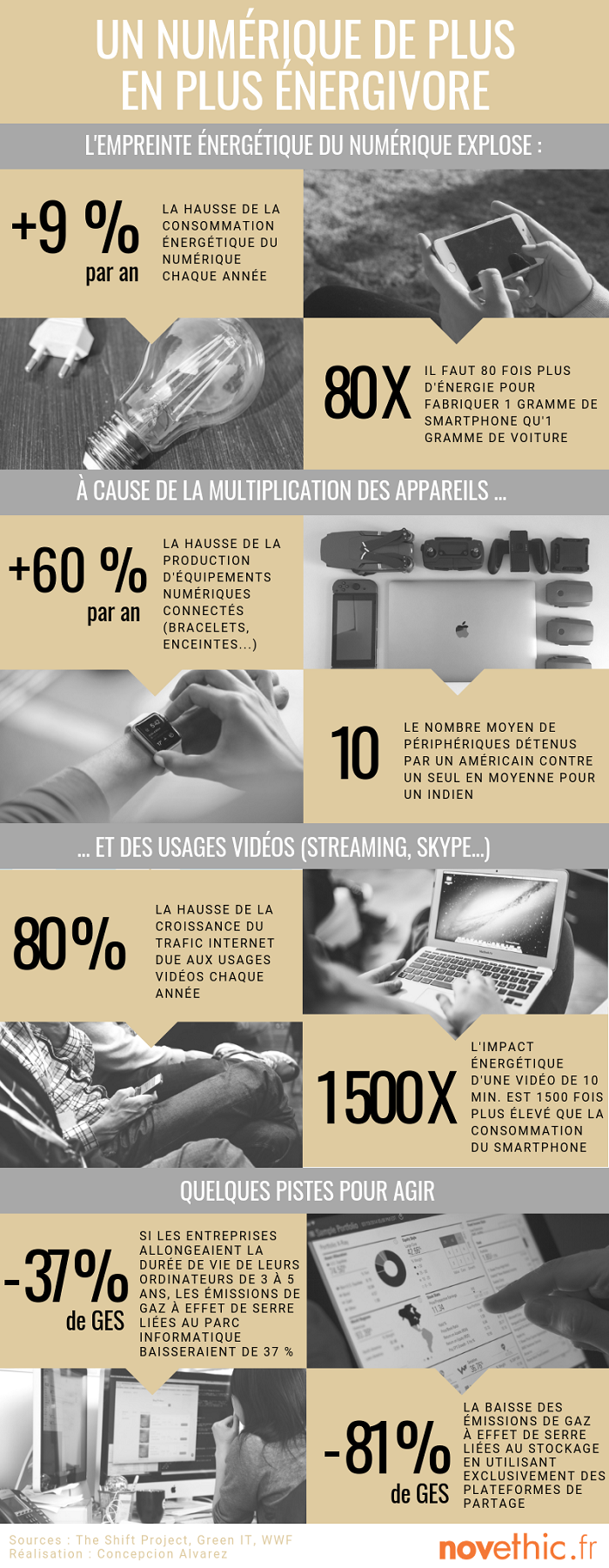


![[UNIIC]](https://uniic.org/wp-content/uploads/2015/11/uniic-logo-top-120.png)