Si l’heure n’est pas à remettre en cause l’efficacité maintes fois démontrée du support papier en tant que véhicule publicitaire et promotionnel, les mesures restrictives visant actuellement l’imprimé non-adressé contraignent les enseignes de grande distribution à penser de nouveaux équilibres. Entretien avec Thomas Rudelle, directeur du marketing digital chez Carrefour, pour qui le print est l’allié objectif de ses déclinaisons numériques…

Thomas Rudelle (©Amélie Marzouk).
Vous êtes directeur du marketing digital chez Carrefour, ce qui ne vous empêche pourtant pas d’insister sur l’efficacité du prospectus papier pour drainer du trafic en magasin… Comment voyez-vous évoluer la complémentarité des supports print et numérique, à l’avenir ?
Nous pouvons nous appuyer sur de nombreuses études qui ont déjà démontré l’efficacité du tract promotionnel papier. Nous savons que c’est un driver majeur de trafic pour nos magasins. Nous n’avons donc aucune raison de nous en passer, sauf si le régulateur nous y oblige. Auquel cas, il nous faudra trouver des alternatives. Le prospectus imprimé aujourd’hui reste un levier publicitaire qui demeure très puissant, même si les usages changent et qu’il nous faut constamment nous adapter. Ce qui nous importe, c’est de coller à ces usages pour proposer le bon média, au bon public, au bon moment. Nous portons là-dessus un regard pragmatique d’efficacité : en fonction des publics cibles, nous actionnons le meilleur levier de communication. Dans la pratique, cela nous amène à combiner le papier et le digital, sans nous arrêter à des oppositions stériles. Bien sûr, nous essayons différentes choses, expérimentons différentes approches et affinons notre stratégie, mais les meilleures réponses s’appuient toujours sur une forme de complémentarité des supports promotionnels.
« Nous savons que le papier est un driver majeur de trafic pour nos magasins. »
Est-ce que l’imprimé publicitaire non-adressé n’est pas encore aujourd’hui une arme concurrentielle, de telle sorte que s’il vous fallait vous en passer sur certains territoires, la déperdition de trafic en magasin se ferait au profit d’enseignes voisines ?
Nous procédons régulièrement à des tests et observons quels peuvent en être les effets, mais nous savons que ces tests sont très observés en magasin. Il est donc parfois difficile de mesurer la part de rationnel dans les résultats que nous mesurons. Les grands acteurs du numérique américains vous diront que le digital c’est formidable, les industriels de l’impression vous diront que le papier c’est formidable, ce qui importe pour nous c’est d’arbitrer au mieux en gardant à l’esprit que toutes les études qui concernent ces sujets sont interprétables. Nous restons donc prudents et vigilants, en ce sens que nous sommes autant que possible à l’écoute de l’évolution des pratiques. Nous mobilisons sur ces sujets des « équipes études » pour mesurer au mieux l’efficacité de nos différents supports de communication, tout en ayant conscience que les tendances sont changeantes et qu’il faut y réfléchir en permanence. Mais aujourd’hui, il n’y a pas de remise en cause de l’importance du papier : nous savons qu’il est incontournable pour la grande majorité de nos magasins.

A la fois conspué tel le symbole d’un consumérisme aveugle et guetté par de nombreux consommateurs avides de bonnes affaires, le Black Friday cristallise les contradictions d’une époque complexe. Il n’est notamment pas rare que des autocollants Stop Pub disparaissent des boites aux lettres à l’approche de l’événement, comme si certains craignaient de rater des offres importantes…
Avez-vous senti une « pression verte » poussant à la digitalisation de la communication ?
J’ai abordé ces sujets avec les GAFA avec lesquels je travaille, et je leur ai posé directement cette question : est-ce que vous pensez que vos canaux sont plus vertueux que ceux du print ? En l’occurrence, ils se savent perfectibles sur certains points, notamment concernant l’efficience environnementale de leurs data center. Ils sont conscients des critiques dont ils peuvent être la cible et ne se présentent pas comme une solution verte face au prétendu « gâchis de papier ». En l’occurrence, je ne suis pas un spécialiste du print, mais j’entends les gens dont c‘est le métier chez Carrefour assurer que le papier que nous utilisons est issu de forêts gérées durablement, que les encres respectent un strict cahier des charges RSE. C’est un message parfois difficile à faire entendre auprès du grand public, mais en termes d’écoresponsabilité, comparer le papier et le digital est quelque chose de complexe. Il y a certainement ici une forme d’injustice, mais entre ce que le destinataire voit concrètement dans sa boite aux lettres, et ce que l’on cache derrière la « dématérialisation » numérique, il y a un possible déficit d’image pour le papier. Tout le monde n’a pas encore le réflexe de se demander ce que pèse un e-mail, alors que ce n’est évidemment pas neutre.
« Plus l’offre promotionnelle est forte et impactante, plus le support papier est pertinent. »
Est-ce que l’imprimé publicitaire adressé, moyennant une possible personnalisation des contenus, fait pour vous figure de solution d’avenir ? Ou est-ce qu’à vos yeux, c’est le digital qui se prête le mieux à ces évolutions ?
C’est une réflexion que nous avons menée en Espagne et que nous aimerions reconduire en France : nous avons demandé à nos clients titulaires d’une carte de fidélité par quel canal ils souhaitaient recevoir nos informations. E-mail, messagerie instantanée, application mobile, prospectus, courrier adressé… Les consommateurs demandeurs d’informations uniquement papier sont plutôt les moins nombreux et les plus âgés. Une grosse majorité réclame du multicanal. Il faut prendre en compte les spécificités d’un pays comme l’Espagne, où l’application de messagerie instantanée Whatsapp est extrêmement répandue, mais ce que l’on observe, ce sont surtout des combinaisons digital + print. Certaines familles de produits, lorsqu’elles bénéficient de grosses offres promotionnelles, comme ce peut être le cas sur des produits électroniques, se prêtent extrêmement bien au catalogue papier, là où les offres un peu plus « standard » liées à des produits de consommation courante, sont plus solubles dans une communication digitale. En quelque sorte, plus l’offre promotionnelle est forte et impactante, plus le support papier est pertinent. Nous réfléchissons aussi à d’autres pistes, comme celle de la Presse Quotidienne Régionale : cela permet de rentrer dans les boîtes aux lettres en générant une émotion, via un médium encore très puissant localement, tout en adressant un contenu publicitaire pertinent. Autre possibilité que ces tests ont soulevée : proposer le catalogue papier en magasin sur des présentoirs scénarisés à cet effet, avec ceux de la semaine en cours à l’entrée du magasin, et ceux de la semaine à venir en sortie de magasin. L’important encore une fois, c’est de proposer du papier au bon moment.

En développant à la fois une gamme de produits spécifiques ainsi même qu’une enseigne « Carrefour Bio », l’enseigne a déjà prouvé qu’elle ne restera pas sourde aux tendances écoresponsables.
La digitalisation massive de la communication subit elle aussi de nombreuses critiques : on commence à mesurer et dénoncer ses impacts environnementaux tout autant que l’on s’inquiète de la collecte de données personnelles qu’elle peut engendrer. Qu’est-ce que cela inspire au directeur du marketing Digital que vous êtes ?
Sur cette question sensible des données personnelles, nous sommes déjà soumis à des contraintes réglementaires que le groupe Carrefour prend on ne peut plus au sérieux. Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) a déjà largement balisé les objectifs à tenir et mobilise des équipes pluridisciplinaires chez nous, dans tous les pays. C’est devenu de toute façon inhérent à la construction-même d’une stratégie globale de marketing digital : nous savons que les notions de transparence et de consentement sont centrales et qu’elles le seront de plus en plus. Ça ne signifie pas pour autant que nous renonçons à la valorisation de la data. La technologie numérique amène à gérer les choses autrement, avec certainement plus de granularité et des remontées statistiques en temps réel, mais je reste convaincu que sur le fond, c’est une méthodologie que nous appliquions déjà avant l’avènement d’Internet. Une enseigne a toujours cherché à connaître ses clients et décrypter les pratiques d’achat. Les outils dont nous disposons aujourd’hui sont en revanche plus puissants, raison pour laquelle la réglementation s’est adaptée.
« Si demain une municipalité comme Grenoble décidait d’instaurer un « Oui Pub », voire d’en faire la règle par-delà son expérimentation, nous réfléchissons déjà à des solutions multicanales d’ajustement. »
Des expérimentations dites « Oui Pub » sont à l’étude dans le cadre du projet de Loi portant lutte contre le dérèglement climatique et ses effets, lui-même extrait des travaux menés pendant neuf mois par les cent cinquante personnes tirées au sort constituant la Convention citoyenne pour le climat… Concrètement, il serait question d’expérimenter pendant trois ans un dispositif d’opt-in sur boites aux lettres, pour les imprimés publicitaires non-adressés, au sein des territoires concernés. Est-ce que ce n’est pas de nature à accélérer un basculement vers une stratégie de communication plus numérique, pour une enseigne telle que la vôtre ?
Nous suivons évidemment cela comme le lait sur le feu… De fait, oui, nous travaillons à des solutions de substitution si le « Oui Pub » devait opérer une percée importante et modifier les équilibres sur lesquels nous avons construit notre stratégie de communication. Nous ne pouvons pas ignorer les répercussions potentielles qu’aurait ce dispositif s’il était largement appliqué. Au-delà de ce que nous percevons aujourd’hui comme étant plus efficace, il y a ce que nous serons en droit de distribuer, tout simplement. Des décrets d’application liés à cette expérimentation peuvent être déposés dès cette année et s’il sera difficile d’être totalement prêts, nous ne pouvons pas nous permettre d’être démunis. Pour autant, il n’est aucunement question de précipiter des décisions qui méritent d’être finement analysées. Si demain une municipalité décidait d’instaurer un « Oui Pub », voire d’en faire la règle par-delà son expérimentation, nous réfléchissons déjà à des solutions multicanales d’ajustement : est-ce que je fais plus de digital ? Plus de PQR ? Plus de radio ? Est-ce que je mets plus de catalogues en libre-service en magasins ? Est-ce que je pousse vers la distribution adressée ? Etc. Ce sont autant de réflexions qui sont menées actuellement, parce que nous ne pouvons pas nous permettre de nous retrouver sans solutions. Nous raisonnons toutefois toujours « à la maille locale » parce que là encore, il serait malvenu de généraliser une seule approche sur l’ensemble du territoire. Comme je l’ai déjà dit, nous tâcherons d’être dans l’analyse la plus fine possible, pour être en phase avec la réalité du terrain.


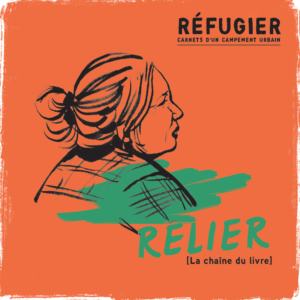


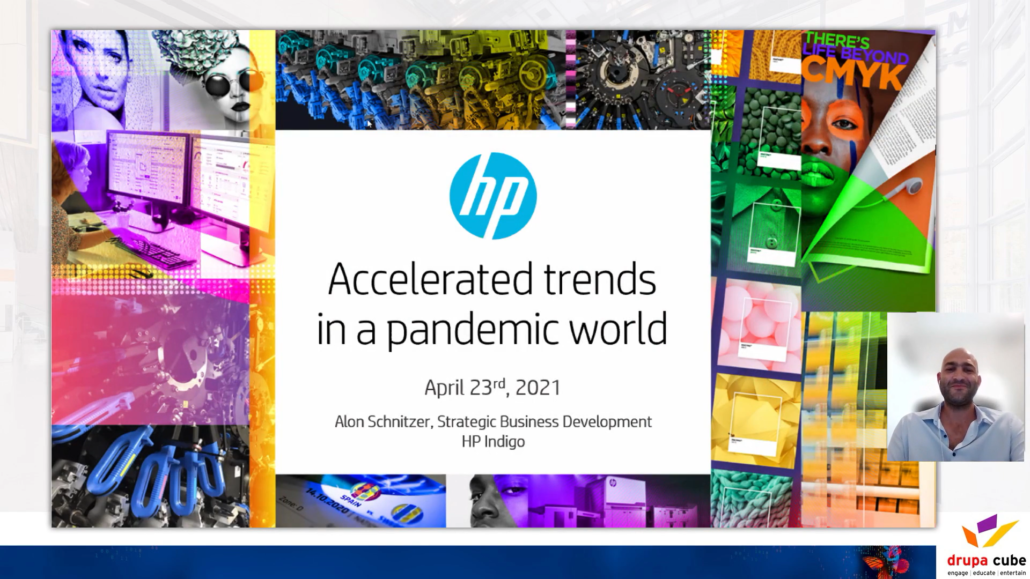



![[UNIIC]](https://uniic.org/wp-content/uploads/2015/11/uniic-logo-top-120.png)