Cet article est paru dans Acteurs de la Filière Graphique n°145 (mars 2024)
ClimateCalc est un calculateur européen qui permet d’estimer l’empreinte carbone d’un site d’impression et des imprimés qu’il réalise. Adapté à des problématiques sectorielles spécifiques, il offre une alternative intéressante aux solutions dont l’approche plus industrielle – au sens large – apparaît moins directement accessible. Comment initier un bilan ClimateCalc et comment conduire une démarche suivie dans le temps ? Nous avons interrogé Matthieu Prevost (Responsable Environnement pour l’UNIIC), qui accompagne les entreprises sur ces questions.
 On a le sentiment que le sujet du bilan carbone explose aujourd’hui dans les Industries Graphiques, alors que CilmateCalc a déjà plus de dix ans…
On a le sentiment que le sujet du bilan carbone explose aujourd’hui dans les Industries Graphiques, alors que CilmateCalc a déjà plus de dix ans…
La problématique des bilans carbone pour le secteur graphique était poussée chez Intergraf il y a déjà presque quinze ans et il a d’abord été créé un consortium avec le Danemark, la Finlande, la Grande-Bretagne, les pays Bas, la Belgique et la France. D’autres pays ont suivi un peu plus tard : Norvège, Portugal, Suède etc. Il faut bien avouer que la France a d’abord été attentiste, malgré de premiers accompagnements tenus dans le cadre d’actions collectives et ça n’a décollé chez nous qu’assez récemment. Mais nous avons refait notre retard en à peine deux ans : les demandes d’entreprises souhaitant rentrer dans cette démarche ont explosé. Et ça ne ralentit plus, en réaction – je pense – à deux types de pressions : celle des donneurs d’ordre qui poursuivent des trajectoires de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) et celle de mesures qui s’inscrivent plus globalement dans le cadre d’une politique climatique, à l’attention notamment des industriels, que ce soit au niveau réglementaire national ou européen. Ce que l’on vit aujourd’hui, ce sont des obligations visant les grosses entreprises, qui ruissellent en cascade sur les entreprises de plus petite taille et/ou les sous-traitants. Et il y a aussi une pression d’image : nous sommes de plus en plus critiqués et à ce titre nous devons nous emparer de ces sujets.
A ce stade, s’agit-il surtout d’offrir une forme de transparence en chiffrant ses impacts, ou y-a-t-il déjà des programmes construits de réduction des émissions chez les entreprises qui s’investissent ?
Il faut d’abord en passer par une phase de collecte, parce que très souvent, on parle d’entreprises qui ne savent pas où elles en sont. Il faut comptabiliser ce qu’on émet avant de prétendre pouvoir réduire. Une fois que l’on a cette photographie, on peut s’inscrire dans une trajectoire et identifier des objectifs de réduction d’émissions de GES. ClimateCalc permet à la fois une approche site et une approche produit. J’ai tendance à dire que l’approche site est un outil de management interne des réductions d’émissions de GES : cela permet très vite de savoir où il faut porter ses efforts au niveau de la structure globale. Et enfin il y a l’onglet ‘produit’ qui permet une approche plus fine, de travailler une forme de pédagogie avec le client pour ‘mieux concevoir’, tout en optimisant des coûts critiques : gâche papier, consommations d’encres etc.

Il apparaît pourtant très vite que le principal poste d’émissions concerne le support d’impression, l’imprimeur n’ayant donc qu’une marge de manœuvre réduite sur ce qui est imputable aux papetiers…
Effectivement, ça peut aller de 60 % à près de 90 % des impacts carbone qui sont directement liés au papier. Le poste support est le premier à citer s’il faut prioriser les actions, mais ça n’est pas toujours si simple. Déjà parce que la décision appartient au client, à ses frais, et qu’il faut faire avec ce qui existe sur le marché. Partout où j’interviens, j’insiste énormément sur la question de la transparence : je demande aux imprimeurs de l’être, il faudra que les papetiers le soient aussi. Dans l’idéal, il ne faudrait plus acheter seulement une référence, mais savoir de quelle usine elle provient. Cette traçabilité n’est pas toujours aisée à établir, parce que si les distributeurs sont précieux pour écouler de petites quantités à des TPE, ils ne tiennent pas toujours à dévoiler leur lieu exact d’approvisionnement. Autre problème : les paper profiles sont trop souvent établis sur du déclaratif et les données sont encore à mon sens trop souvent imprécises ou lacunaires. On constate d’ailleurs parfois que deux papiers provenant de deux usines différentes ont exactement le même paper profile, ce qui n’est évidemment pas cohérent. Une fois qu’on a dit ça, oui, on peut aller travailler sur le sourcing fournisseurs et c’est ce que font certains imprimeurs que nous accompagnons : ils regardent quelles sont les lignes les plus impactantes de leur bilan carbone et tâchent de les faire sauter, à condition bien sûr que ce soit économiquement viable. A ce stade, il faut être réaliste : l’aspect carbone n’est pas encore un levier essentiel dans la prise de décision du donneur d’ordre, mais c’est un paramètre qui compte de plus en plus. Il faut essayer de se positionner au bon point d’équilibre. Souvent, c’est le volume qui fait le prix : selon ce que le papetier a en stock et selon ce que l’imprimeur veut commander, le prix va être ajusté. L’approche carbone n’arrive encore qu’en dernier ressort. Rares sont les clients qui disent aujourd’hui « Je me moque du prix, je veux le papier le plus vertueux ». Par ailleurs, il faut évidemment faire des choix cohérents au regard de ce que l’on veut produire : on ne va pas prendre un papier exemplaire d’un point de vue ‘impact carbone’, s’il n’est pas adapté à ce que l’on veut faire. Typiquement, les papiers d’art sont des supports très qualitatifs et ils réclament souvent plus de traitements que d’autres.
ClimateCalc a aussi été créé pour offrir au secteur un outil sur-mesure. Pourquoi est-ce que c’était important ?
C’est un produit de fédérations européennes et en cela, ClimateCalc est un outil collectif neutre : ce n’est pas un générateur de business pour des consultants privés, il est déjà très important de le souligner. A ce titre, les tarifs que nous proposons sont aussi bas que possible : 1200 euros pour un accompagnement et trois jours d’audit, ça n’est une réalité que parce que des fédérations comme l’UNIIC en ont fait un outil collectif. Concrètement, une entreprise prend contact avec, soit l’UNIIC, soit le cabinet Ecograf – l’un et l’autre travaillant en bonne intelligence – et en premier lieu, on présente la démarche. On s’assure de la viabilité du projet, de la motivation de l’imprimeur et de sa capacité à ‘jouer le jeu’. Il faut bien avoir conscience que la première année demande un gros travail de collecte de données, pour faire un état des lieux aussi juste et précis que possible. On me demande souvent combien de temps cela va prendre, mais cela dépend beaucoup de la structuration de l’entreprise, de son profil, de sa taille etc. C’est très variable au cas par cas et une moyenne ne serait pas très parlante : ça peut prendre une semaine comme plusieurs mois. Après avoir présenté l’outil, on essaie de déterminer ce qui motive l’initiative de l’entreprise – est-ce que ce sont des pressions clients ou une volonté proactive d’afficher un engagement exemplaire ? – et on rentre dans le dur du protocole GHG [Greenhouse Gas Protocol ou GHG Protocol, que l’on peut traduire en français par protocole des gaz à effet de serre, NDLR] et de la norme ISO 14064. Il est essentiel de redire que nous nous appuyons donc là sur des normes et protocoles éprouvés, parce qu’il n’est malheureusement pas rare de voir des consultants proposer leurs propres bilans carbone, sans que l’on sache vraiment sur quoi ils sont basés.
Les initiés parlent souvent de trois « scopes » comme si le bilan carbone était invariablement structuré partout de la même façon. Est-ce concrètement le cas ?
On doit effectivement considérer trois scopes d’intervention :
– Dans le scope 1, on considère les émissions de GES directement liées à l’usine.
– Dans le scope 2, on s’attache aux consommations d’énergie.
– Dans le scope 3, on rentre les données relatives aux sous-traitants et consommables.
Le plus gros du travail réside sans surprise dans le scope 3 et il est pourtant arrivé que certaines entreprises aient suivi des bilans carbone portés par des consultants, en ne prenant en compte que les scopes 1 et 2. Ça n’a évidemment aucun sens et il est primordial que tout le monde s’appuie sur le même périmètre de mesures. Ensuite on détermine une temporalité : les données de l’entreprise doivent être mises à jour tous les ans pour que l’on puisse suivre les émissions de CO2. Soit on prend pour référence une année civile, soit on prend une année comptable : ce qui compte, c’est de pouvoir faire des comparaisons valables dans le temps. Une fois que tout est prêt, on fait une demande de connexion au calculateur ClimateCalc et c’est la fédération danoise qui nous envoie des logins, sachant que l’outil – encore une fois – a été voulu très simple d’utilisation. En treize paramètres, on couvre l’ensemble des émissions de GES d’une imprimerie, sans se perdre dans des considérations hors-sujet.
L’enjeu a semblé en effet largement consister à rendre l’outil accessible, là où les quelques-uns qui se sont frottés à des bilans carbone multisectoriels témoignent d’une démarche excessivement complexe…
C’est un outil en ligne et pour moi cela rentre tout à fait dans la catégorie formation/action. L’idéal, c’est que l’entreprise soit autonome après la première année, pour rentrer elle-même ses données. On organise bien sûr quand même des réunions de cadrage régulières, qui me permettent de suivre la façon dont sont collectées et rentrées les données et si besoin, j’interviens pour réorienter l’action de l’entreprise. Lors de ces réunions de cadrage, on passe en revue toutes les informations qu’il va falloir collecter, au regard du profil de l’entreprise : son parc machines, ses consommations énergétiques etc. Tout ça se fait à distance et cela me permet de leur livrer un fichier de collecte de données en priorisant les actions. Tout est fait pour leur faciliter la tâche : je leur donne même des exemples d’extractions de données, je leur fournis des modèles de lettre pour leurs fournisseurs en français et en anglais etc. C’est souvent le poste ‘papier’ qui pèse le plus lourd et on commence en général par celui-là. Le premier audit n’est programmé que lorsque l’entreprise est prête. Si tout se passe bien, un certificat ClimateCalc leur sera décerné, pour attester que la démarche de l’entreprise est conforme aux critères du protocole GHG et de la norme ISO 14064. C’est tamponné par l’UNIIC et pendant un an, ils peuvent utiliser le calculateur et accéder à l’onglet ‘produit’. Cela nécessite une formation rapide avec des études de cas sur des calculs produits, pour que les commerciaux et deviseurs deviennent autonomes sur l’outil. Je les incite à mettre en place des procédures en interne pour déterminer où est l’information et comment la récupérer au mieux. Cela permet de créer des automatismes sur le long terme, de sorte que l’on gagnera du temps d’une année sur l’autre. La première année est donc quasi-systématiquement plus compliquée, parce qu’elle nécessite d’identifier les données dont on a besoin, mais aussi de trouver et d’impliquer les personnes ressources dans l’entreprise. A ce titre, ce sont des ‘responsables de la donnée’ et ils doivent pouvoir s’appuyer sur des éléments de preuve : pour satisfaire à un audit, il faut toujours prouver ce que l’on dit.
Arrive-t-il que certaines données demeurent malgré tout manquantes et que fait-on pour ne pas bloquer les bonnes volontés ?
Heureusement, on dispose d’une marge de manœuvre pour affiner les données qui seraient difficiles à évaluer en interne. Par exemple : sur un site de plus de 500 personnes fonctionnant en 3/8 avec beaucoup d’intérimaires, il est quasi-impossible de calculer les trajets domicile/entreprise. Dans ces cas-là, on s’appuie sur des fichiers RH pour déterminer combien de cartes de transport sont partiellement ou totalement remboursées, pour évaluer combien prennent la voiture ou les transports en commun, à quelle fréquence etc. A partir de là, on applique des consommations moyennes en fonction du mode de locomotion, au plus proche de ce que l’on peut estimer. On le fait bien sûr avec des données certifiées, il ne s’agit pas d’y aller au doigt mouillé. Par ailleurs, on se le permet sur des postes qui ne sont pas des postes majeurs d’émissions de GES, de façon à ce que ces estimations soient à la fois très fines et d’importance secondaire dans le calcul global. Typiquement, je ne veux pas faire ça sur le poste papier/carton : pour que l’audit passe, il suffirait de renseigner plus de 50 % des références papier, mais dans les faits, on s’oblige à approcher les 100 %. J’estime qu’il faut avoir cette exigence-là et se laisser de la marge ailleurs, quand c’est nécessaire.
On est dans une démarche de normalisation avec des items à renseigner. Prenons l’exemple des plaques : pour un imprimeur offset, il faudra rentrer une consommation annuelle de plaques, en tonnes. Soit ces données existent déjà, soit il va falloir aller les chercher, par exemple en faisant des extractions à partir d’un ERP sur tous les jobs de l’année. Ensuite, via le CTP on connaît le format et l’épaisseur des plaques utilisées, ce qui nous rend capables de déterminer un poids. On peut aussi solliciter la comptabilité pour retrouver les commandes de plaques et interroger les données fournisseurs. C’est là que l’accompagnement prend tout son sens : souvent, ces informations ne sont pas impossibles à avoir, elles demandent juste un travail d’analyse et de déduction que l’on est capable de mener au cas par cas, selon la façon dont l’entreprise fonctionne. Pour le poste le plus lourd – celui du papier – on commence en général par faire une extraction de l’ERP pour savoir ce que l’entreprise a ‘roulé’ comme type de papiers au fil de l’année. C’est plutôt simple à établir lorsque les achats ont été effectués en direct auprès du papetier, ça l’est moins si l’on passe par un distributeur : il va falloir traduire les références des distributeurs, les mettre en parallèle avec celles du papetier et identifier l’usine de provenance. Une fois que l’on a fait ça, il faudra s’appuyer sur un paper profile à jour, ce qui n’est pas toujours facile non plus. Là encore, c’est toujours plus complexe la première année : une fois que ce travail est fait, on peut dupliquer ces données et les appliquer à de nouveaux volumes.
Comment gère-t-on les cas d’entreprises qui ont grossi et/ou investi, de telle manière que leur volume d’affaires a pu augmenter, sur des marchés potentiellement nouveaux pour eux ? En soi, l’entreprise sera plus émettrice en valeur absolue, même si elle travaille mieux…
Pour les entreprises qui auront plus imprimé et donc émis plus de CO2, par le seul fait d’une activité en progression, on a indicateur de CO2 à la tonne transformée. C’est en soi plus parlant qu’un total qui ne veut pas dire grand-chose. La performance d’une entreprise se mesurera plus justement à la lumière d’un prorata à la tonne imprimée. Par exemple, pour la gâche papier : pour établir une moyenne sur site, on rentre la quantité totale de papier imprimé à l’année versus le volume de déchets récupérés par le prestataire agréé : on sait que la différence entre l’un et l’autre, c’est du calage machines, de la rogne etc. A partir de là, il est assez facile d’établir un taux de gâche moyen. Il faudrait aussi parler de certaines imprimeries qui partent avec un handicap, dans la mesure où il sera plus difficile d’être exemplaire avec des sites un peu vétustes. On ne peut pas tout corriger par des ajustements et quand on travaille dans des bâtiments qui sont des passoires énergétiques, on a une marge d’amélioration à court/moyen terme qui ne nous permettra pas forcément d’afficher un bilan carbone aussi performant que d’autres entreprises mieux installées ou plus modernes. C’est pour cela que je pense vraiment qu’il faut appuyer l’idée de progrès : l’important, c’est que chacun s’attache à faire mieux, avec ses propres marges de progrès.
La tentation sera grande pour les donneurs d’ordre d’en faire un outil de comparaison, pour mettre les entreprises en compétition entre elles…
Le risque, c’est de comparer tout et n’importe quoi : des imprimeurs offset feuille et/ou roto, des imprimeurs numérique grand format, des sérigraphes etc. ClimateCalc permet aux entreprises d’effectuer des comparaisons européennes en fonction des procédés d’impression, ce qui est déjà plus parlant. Mais même là, ce sont en vérité des exercices assez bancals : avec un même procédé, on peut être positionné des sur des qualités de produits très différentes et être amalgamé avec des imprimeurs qui n’auront pas du tout les mêmes obligations techniques et qualitatives.
Ne risque-t-on pas de voir des donneurs d’ordre exiger une évaluation carbone avant de passer commande, au moment du devis par exemple ?
Un client pourra le faire oui, mais ce n’est pas forcément comme ça que cela va se passer. Il y a quinze ans, certaines marques ont poussé leurs imprimeurs à avoir une certification ISO 9001 pour continuer de les référencer. Résultat : certains ont dû se priver de la moitié de leurs sous-traitants, parce qu’il y a une réalité industrielle qui les a rattrapés. Du coup, ils ont rectifié le tir en demandant aux entreprises de mettre en place des démarches, sans forcément aller jusqu’à la certification. Ce sera à peu près la même chose avec le bilan carbone : attention à ne pas être trop restrictif. On compte environ une centaine d’utilisateurs de ClimateCalc aujourd’hui en France (contre 169 au total dans le monde), c’est une toute petite élite au regard du tissu industriel puisqu’on dénombre environ 4000 imprimeries à l’échelle de notre pays. Il faut accompagner le mouvement, sans se précipiter pour autant. Si aujourd’hui, un imprimeur devait indiquer sur son devis une estimation d’impact carbone pour la soumettre à son client, il faudrait y consacrer un poste à temps plein. En plus, les simulations impliquent souvent de chiffrer différentes hypothèses, selon les papiers choisis, le nombre d’exemplaires commandés, le procédé d’impression retenu etc. C’est rapidement très chronophage. Il n’empêche que oui, il y a des donneurs d’ordre qui vont entamer tout une réflexion autour de leurs rapports aux sous-traitants, en essayant par exemple de travailler avec des acteurs locaux en circuit court.
Est-ce que lors de la première phase d’accompagnement, il peut être pointé chez l’entreprise des éventuelles contreperformances ciblées, pour dire par exemple « sur ce point, il va falloir faire mieux » ?
Oui, j’ai une marge de manœuvre et je le dis. J’ai travaillé notamment avec des imprimeurs qui utilisent des papiers techniques et fonctionnels, au sujet desquels il manque parfois des données. Dans ces cas-là, on effectue des calculs en prenant en considération les scénarios les plus critiques, ce qui n’est pas pour les arranger. Dans ce cas-là, je les sensibilise au fait qu’en ayant une meilleure remontée des données, non seulement on sera plus précis, mais ce sera à leur avantage. Plus globalement, l’audit sert à ça : que peut-on mettre en place pour affiner et réduire les émissions de CO2 ? Certains vont devoir travailler prioritairement sur leurs consommations d’énergie, d’autres sur des optimisations internes en termes de calages machines ou de consommation de plaques, d’autres sur le taux d’encrage etc. Mais encore une fois, tout ça, ce sont finalement de petits postes d’amélioration, l’essentiel des efforts porte souvent sur le sourcing papier. C’est une fois qu’on a travaillé sérieusement là-dessus qu’on s’attaque à réduire les autres postes.
On l’a dit, ClimateCalc est un outil qui a déjà une certaine ancienneté. Le site Internet n’est pas devenu obsolète ou un peu « daté » avec le temps ?
Le site vient d’être totalement refait et il va encore évoluer lors des prochains mois. Nos bases de données sont régulièrement mises à jour et nous affinons les données selon l’état de ce que nous savons des facteurs d’émissions attachés à tel ou tel poste. Le but, c’est vraiment d’être au taquet sur l’ensemble des facteurs d’émissions, pour proposer le calculateur le plus précis à l’heure actuelle. C’est quelque chose qui change perpétuellement, au gré notamment des informations existantes dans les bases de données et des progrès chez les fabricants de machines, donc rien n’est arrêté. Par ailleurs, l’accès au calculateur est paramétrable : le dirigeant d’entreprise peut accéder à tout, tandis que d’autres profils pourront par exemple n’accéder qu’à des fonctions qui les concernent sur du calcul produit.
 Le mot d’Ecograf
Le mot d’Ecograf
Ecograf accompagne aussi les acheteurs d’imprimés, éditeurs (presse magazine, livres), agences de production dans l’estimation de leur empreinte carbone.
« Les imprimeurs doivent comprendre que leurs clients n’ont pas le choix : ils doivent estimer leurs émissions de gaz à effet de serre en vue de les réduire. Si les imprimeurs ne sont pas capables de transmettre une information robuste accompagnée de solutions d’optimisation, la seule alternative s’offrant aux acheteurs pour réduire leurs émissions sera de réduire leur volume d’achats. Estimer ses propres émissions ne revient donc pas, comme on peut l’entendre, à se tirer une balle dans le pied, mais bien à tenter de maintenir ses volumes. En proposant des grammages plus faibles, des formats mieux adaptés permettant de réduire la gâche, des solutions innovantes, l’imprimeur offrira la possibilité à son client d’atteindre ses objectifs de réduction. Enfin, ce travail doit s’accompagner d’une révolution culturelle : le concept de chaîne graphique (où la fin de la chaîne subit les décisions du début) doit être remplacé par un concept d’écosystème graphique. Chaque unité constitutive de cet écosystème doit partager un objectif commun de réduction des émissions de l’ensemble. C’est par le partage, l’écoute et la co-construction que cet objectif, ardu, sera rempli. Même si la majorité du marché n’attend toujours qu’un prix, un délai et une qualité, la minorité du marché qui a déjà fait sa mutation mérite que l’on y prête attention. »
Témoignages
ClimateCalc par ses utilisateurs
Ils sont quelques pionniers – une centaine – à avoir adopté l’outil en France. De différents profils, ils dressent des constats à la fois semblables et complémentaires, sans toutefois viser tous les mêmes objectifs. Petit tour d’horizon…
KVC Print
 Jérôme Jallu (Directeur général adjoint) – « Echanger avec ses clients pour s’entendre sur des axes de progrès. »
Jérôme Jallu (Directeur général adjoint) – « Echanger avec ses clients pour s’entendre sur des axes de progrès. »
KVC Print répond aux marchés de l’impression/fabrication de supports de communication grand format, offset et numérique, intérieur et extérieur : affiches, PLV, signalétique, adhésifs, bâches etc. La démarche ClimateCalc s’est imposée à nous d’abord lorsqu’il a fallu répondre aux demandes de nos clients, principalement les grands acteurs de l’industrie du luxe, de l’automobile ou des télécommunications, qui se sont engagés à une neutralité carbone à horizon 2035. Puis chemin faisant, nous avons voulu quantifier nos émissions et entrer dans une démarche d’amélioration de notre empreinte. En particulier en travaillant sur nos bâtiments, nos approvisionnements et en proposant des solutions en circuit court à nos clients. Tout ce travail nous permet donc à la fois de répondre à une demande qui est concrète, mais aussi en interne de mettre en exergue nos propres points d’amélioration. Est-ce que cela soulève des défis ? Oui ! Côté entreprise, cela implique des investissements importants : un changement de matériel ou de type d’énergie par exemple. Côté clients, les solutions peuvent être coûteuses : changer de papier ou de technologie d’impression par exemple. Mais l’important est d’échanger avec ses clients pour s’entendre sur des axes de progrès, selon les possibilités de chacun.
Grafik Plus
 Aurore Le Corre (Directrice du développement) – « Proposer un devis A et un devis B, avec deux papiers différents, tout en expliquant les différences d’impact carbone. »
Aurore Le Corre (Directrice du développement) – « Proposer un devis A et un devis B, avec deux papiers différents, tout en expliquant les différences d’impact carbone. »
La question de notre empreinte carbone a vraiment commencée à être traitée il y a bientôt trois ans. A l’époque, on sentait déjà quelques frémissements en ce sens chez nos plus gros clients, certains nous demandant si nous avions fait des bilans carbone, mais on restait dans du déclaratif. On a fait partie des fous qui avaient essayé, avant ClimateCalc, d’utiliser le tableur de l’ADEME [RIRES]. Mais c’était très difficile de gérer ça seul et beaucoup d’informations demandées n’avaient rien à voir avec les industries graphiques. Il fallait presque des compétences d’ingénieur pour renseigner certains champs et sauf à passer par des consultants ou y consacrer énormément de temps, c’était infaisable. Pire encore : on mettait le curseur de notre bilan où on le souhaitait : scope 1, 2 ou 3, au choix. C’était donc à la fois plus compliqué, moins pertinent par rapport à la réalité de nos métiers et moins rigoureux. ClimateCalc nous a permis d’aller au bout de la démarche, tout en offrant une meilleure maîtrise de l’outil. Notre premier bilan ClimateCalc a été fait en 2023, sur la base de nos données 2022, et avons obtenu notre certificat en novembre dernier. Il a fallu beaucoup travailler avec la comptabilité pour obtenir tous les chiffres nécessaires, même si dans le cadre d’une démarche RSE entamée chez Grafik Plus depuis 2008, nous avions déjà mis pas mal d’indicateurs en place, ce qui nous a bien aidés. Cela nous a permis de débriefer dès fin 2023 avec nos clients les plus sensibles sur ces questions, à minima pour pouvoir faire différentes propositions : par exemple un devis A et un devis B, avec deux papiers différents, tout en expliquant les différences d’impact carbone. On essaie d’accompagner nos clients vers les meilleures alternatives, sachant que les mesures brutes d’impact carbone sont peu parlantes en soi : on a besoin de comparatifs pour commencer à mesurer les progrès que l’on peut faire. C’est du moins vrai pour les mesures produits, ce qui concerne le site a davantage d’utilité pour nous, en interne. Ce que l’on peut partager avec les clients, ce sont des objectifs d’amélioration. De toute façon, l’essentiel de la marge que l’on a est souvent sur le support d’impression : chez Grafik Plus, le papier pèse 60 à 70 % de notre impact carbone. Il est facile d’en proposer d’autres, avec de meilleurs paper profiles, mais quand on est verrouillés sur des marchés où le client est vraiment attaché à une référence, il faut essayer de trouver d’autres leviers.
Groupe Prenant
Juliette Guillermou (Cheffe de projet) & Philippe Vanheste (Directeur général adjoint) – « On aiguille au mieux nos clients pour qu’ils fassent des choix éclairés, sachant que les papiers pèsent aujourd’hui pour plus de 71 % de notre empreinte carbone. »
 PV : Nous avons renforcé l’approche RSE du groupe il y a dix ans, pas tant sur un plan normatif que volontaire. Dans cette optique, nous avions à l’époque certainement plongé trop vite dans une démarche de bilan carbone, sans être prêts : les exigences étaient telles que cela s’est avéré inapplicable. Ce qui m’a séduit avec ClimateCalc, c’est qu’on ne nous demande pas l’impossible : si on n’est pas tout de suite en mesure de renseigner certaines informations, on peut se raccrocher à des valeurs moyennes et avancer. Le fait que ce soit un outil collectif européen facilite l’appropriation d’une démarche qui reste abordable, que l’on soit une petite ou une grande entreprise. L’intérêt premier, à ce stade de notre démarche, c’est de pouvoir garantir aux clients une transparence. C’est le fait de pouvoir leur dire : « Vous faîtes 20 000 brochures, on est en capacité de vous dire quel est l’impact carbone de cette production, avec des estimations directement sur le devis et/ou sur la facture ». Les pistes d’amélioration sont pour nous la prochaine étape.
PV : Nous avons renforcé l’approche RSE du groupe il y a dix ans, pas tant sur un plan normatif que volontaire. Dans cette optique, nous avions à l’époque certainement plongé trop vite dans une démarche de bilan carbone, sans être prêts : les exigences étaient telles que cela s’est avéré inapplicable. Ce qui m’a séduit avec ClimateCalc, c’est qu’on ne nous demande pas l’impossible : si on n’est pas tout de suite en mesure de renseigner certaines informations, on peut se raccrocher à des valeurs moyennes et avancer. Le fait que ce soit un outil collectif européen facilite l’appropriation d’une démarche qui reste abordable, que l’on soit une petite ou une grande entreprise. L’intérêt premier, à ce stade de notre démarche, c’est de pouvoir garantir aux clients une transparence. C’est le fait de pouvoir leur dire : « Vous faîtes 20 000 brochures, on est en capacité de vous dire quel est l’impact carbone de cette production, avec des estimations directement sur le devis et/ou sur la facture ». Les pistes d’amélioration sont pour nous la prochaine étape.
 JG : Nous avons aujourd’hui une base d’informations solides pour travailler sur le long terme une baisse de nos émissions carbone, mais il faut que ça concorde avec des impératifs économiques. La crise de l’énergie nous a par exemple contraints à gérer une urgence en termes de maîtrise des coûts. La dimension économique existe aussi pour les clients, lorsqu’ils doivent choisir un papier : même les plus investis font des compromis. Typiquement, choisir un papier recyclé est très compliqué : l’impact carbone va varier énormément selon les propriétés qu’on en attend et selon son lieu de production. On sait par exemple que si c’est en Suisse, avec une énergie globalement hyper-décarbonée, c’est l’idéal. Mais à quel prix ? On les aiguille au mieux pour qu’ils fassent des choix éclairés, sachant que les papiers pèsent aujourd’hui pour plus de 71 % de notre empreinte carbone. Cela étant dit, on voit apparaître la notion de bilan carbone dans des appels d’offre aujourd’hui : c’est une vraie évolution, ça n’était pas aussi explicite quelques années auparavant.
JG : Nous avons aujourd’hui une base d’informations solides pour travailler sur le long terme une baisse de nos émissions carbone, mais il faut que ça concorde avec des impératifs économiques. La crise de l’énergie nous a par exemple contraints à gérer une urgence en termes de maîtrise des coûts. La dimension économique existe aussi pour les clients, lorsqu’ils doivent choisir un papier : même les plus investis font des compromis. Typiquement, choisir un papier recyclé est très compliqué : l’impact carbone va varier énormément selon les propriétés qu’on en attend et selon son lieu de production. On sait par exemple que si c’est en Suisse, avec une énergie globalement hyper-décarbonée, c’est l’idéal. Mais à quel prix ? On les aiguille au mieux pour qu’ils fassent des choix éclairés, sachant que les papiers pèsent aujourd’hui pour plus de 71 % de notre empreinte carbone. Cela étant dit, on voit apparaître la notion de bilan carbone dans des appels d’offre aujourd’hui : c’est une vraie évolution, ça n’était pas aussi explicite quelques années auparavant.
Nortier Emballages
 Sandra Cloarec (Responsable RSE & QSE) – « Nous sommes toujours force de proposition. »
Sandra Cloarec (Responsable RSE & QSE) – « Nous sommes toujours force de proposition. »
ClimateCalc est un engagement de longue date pour nous, puisque cela a débuté en 2014. Mais nous n’étions probablement pas assez mûrs à l’époque, raison pour laquelle ça n’a abouti que récemment, avec un vrai coup de boost consécutif à notre labellisation Print Ethic : c’est via l’enjeu 10 que nous avons pu relancer un bilan carbone, sachant que nous étions dans le même temps challengés de façon récurrente par nos clients sur cette question : quelle empreinte carbone pour tel produit ? Quelles actions mettez-vous en place ? Etc. Dans le milieu du packaging cosmétique de luxe, c’est devenu une préoccupation très sensible. Nous aurions pu prendre un autre outil, mais dans la mesure où ClimateCalc est pensé spécifiquement pour les industries graphiques, avec un réel accompagnement, cela lui confère un net avantage. A ce stade de la démarche, nous avons d’ores et déjà décidé de nous faire accompagner pour mieux comprendre et optimiser nos consommations énergétiques. Mais la question la plus complexe finalement, c’est celle de savoir ce que l’on fait des résultats que nous obtenons sur le calculateur. Sur la partie mesurant les impacts du site d’impression, c’est peu lisible d’un point de vue extérieur et sans contextualisation, c’est difficile à interpréter. Pour les produits, nous sommes toujours force de proposition auprès de nos clients avec des propositions écoconçues.
Cloître Imprimeur
 Anne-Emmanuelle Crivelli (Responsable RSE & Innovation) – « Privilégier l’impact bas carbone, privilégier le local ou privilégier le recyclé, ce n’est pas forcément se rendre aux mêmes choix. »
Anne-Emmanuelle Crivelli (Responsable RSE & Innovation) – « Privilégier l’impact bas carbone, privilégier le local ou privilégier le recyclé, ce n’est pas forcément se rendre aux mêmes choix. »
ClimateCalc est un précieux outil de progrès, mais pour comparer différents imprimeurs entre eux, c’est déjà plus compliqué : un chiffre d’émissions de CO2 ne suffit pas, il faut comparer des démarches RSE, des démarches de certification, des parcs machines, des politiques d’intégration notamment vis-à-vis du handicap etc. Le bilan carbone est à mon sens un levier parmi d’autres, mais grâce à ClimateCalc, je pourrai par exemple à terme proposer à nos clients une option bas carbone : parce que je suis maintenant en mesure de calculer l’impact CO2 de nos produits et donc de proposer des alternatives, en travaillant notamment sur le support d’impression. Mais il faut bien avoir conscience que selon ses priorités, on ne tirera pas les mêmes conclusions : privilégier l’impact bas carbone, privilégier le local ou privilégier le recyclé, ce n’est pas forcément se rendre aux mêmes choix. Ce sont des engagements complémentaires et qui tirent évidemment dans le même sens, mais j’essaie de dire à nos clients qu’il n’existe pas d’approche-type qui concentre à elle seule toutes les bonnes pratiques. Il s’agira toujours de trancher, en fonction de ses objectifs.




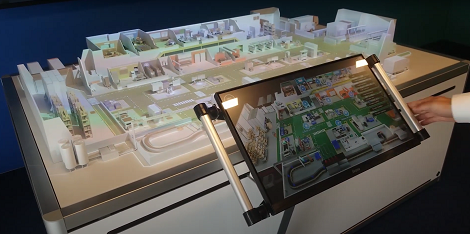
























![[UNIIC]](https://uniic.org/wp-content/uploads/2015/11/uniic-logo-top-120.png)